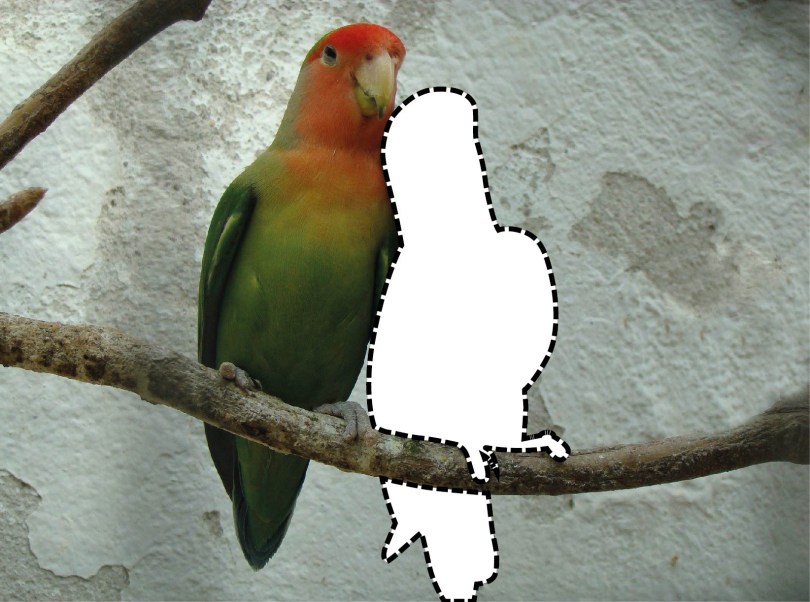Lorsque la nuit tombe sur Malartic, loin des lumières de la ville, tous les cadavres de voiture de la cour à scrap prennent la même couleur gris sombre, comme des centaines de chats gris qui se seraient étendus dans le champ, dans toutes les directions et qui dorment paisiblement. Il vient des nuits sans étoiles et sans lunes, où le seul éclairage vient des essaims de lucioles qui apparaissent aux premières soirées chaudes d’été. Leurs derrières de feu font renaître un bref moment de minuscules auréoles de couleur, celles de la peinture usée des carrosseries qui jonchent le sol, gros Chrysler vert menthe, petite Volkswagen orange, la couleur du tissu élimé de la banquette d’une vieille Cadillac décapotable, là où sont collés l’un contre l’autre deux enfants d’à peine huit ou neuf ans, les yeux partout, ébaubis. Camille, petite fille un peu garçonne, fille de la propriétaire de la cour à scrap, que tous appellent simplement Cam. Et Léon, un petit blond le visage picoté de taches de rousseur dont la famille plutôt pauvre habite Roc d’Or, un squat un peu en-dehors de la ville, passé la cour à scrap. Ces soirs-là, ils y sont toujours sans avoir à s’appeler, s’y donner rendez-vous. Dès que les premières lucioles apparaissent, ils s’y retrouvent. Ils se réchauffent l’un contre l’autre sur la banquette arrière d’un gros décapotable qui sent le chalet abandonné, grignotent quelque ravitaillement rapiné ici ou là, se racontent des peurs ou les pires commérages du moment, s’apprennent à l’occasion, et délicatement, l’un à l’autre les différences fondamentales entre ce qu’est un garçon, ce qu’est une fille. Une amitié profonde qui remonte au berceau, les deux enfants semblent n’afficher leur propre couleur que lorsqu’ils sont un avec l’autre, l’un contre l’autre toujours comme des siamois. Cam et Léon, caméléons!, leur crie-t-on en s’esclaffant.
…
Comme le soleil finit de disparaître derrière la ligne d’horizon au fond de la cour à scrap où elle passe ses journées d’été à chercher, à démancher et à rapporter des pièces pour sa mère la patronne, le frère de Camille et ses amis se pointent, à peu près tous gelés comme des balles et en pleine galère. Son frère lui file cinquante piastres de la part de sa mère, cinquante piastres et un billet d’entrée pour le cirque tout juste débarqué en ville; la mère a parlé d’un spectacle de tigre qui serait une toute nouvelle attraction qu’elle devrait absolument aller voir et je ne sais quoi d’autre. Les mouches à feu s’en donnent à coeur joie alentour et même dans les cadavres de voitures qui jonchent la place et elles donnent un spectacle au moins aussi bon qu’un stupide spectacle de tigre, pense Camille qui a en sainte horreur l’idée qu’on puisse maltraiter des animaux. Cent fois mieux les mouches à feu, spécialement avec la musique d’Esther Phillips qui sort de son vieux boombox. Évidemment Léon va se pointer dans pas long, c’est écrit dans le ciel comme dans le cul des mouches à feu. Camille prendra son billet d’entrée pour elle et le beau billet de cinquante rose fera amplement les frais pour celui de Léon.
…
Camille et Léon attendent que le flic retienne la ligne de voitures et les laisse traverser à pied la grande route vers le cirque de l’autre côté. La grosse noirceur vient de tomber et tous ces néons et toutes ces fumées de barbecue et les relents excitants des friteuses à beignes, des machines à mousse et l’odeur des cigarettes et des feux de bois, du diésel et des génératrices se pendent aux brumes d’une des rares soirées chaudes et humides de l’été abitibien.
Les phares qui viennent de la grande route projettent de longues ombres mobiles qui circulent et se croisent partout sur les installations du cirque, se faufilent entre les stands de mousse et de queues de castor, la piscine folle du clown Henri, le chapiteau où sont exhibés sans pudeur des pastiches d’atrocités humaines et pas mal toutes les tentes et les manèges, finalement. Une fois traversé le terrain de la foire, le champ derrière où sont disposées comme un vrai capharnaüm les remorques du cirque, où logent tous ces nomades, les Airstream ou les Winnebagos leurs feux ou leurs phares allumés et les feux de camp et les génératrices et tous les Hé, qu’est-ce que vous faites icitte, vous avez pas le droit! et tous les Fuck you! qu’ils font résonner jusqu’à la colline derrière où était la vieille école qui est passée au feu l’hiver dernier, là où on a entrepris de construire un Walmart, parfois ce n’est plus rien que les rires gras des clowns et les bruits de moteurs qu’on peut entendre, en haut de toute cette étrange vie temporaire, sur la colline, on peut entendre le bourdonnement des mouches et les croassements des batraciens et les cris d’oiseaux et si on est vraiment chanceux, le feulement d’un lynx.
Après qu’ils aient tout laissé derrière, la grande route, la foire, le campement et les Fuck you!, Camille et Léon courent.
L’air est pesant et chaud, ça colle à la peau. Léon se débarrasse de sa chemise, la lance dans les airs et hurle comme un loup. Camille fout une grande claque qui résonne sur le ventre nu de Léon. Des générations spontanées de moustiques émergent des flaques d’eau du chantier pour se précipiter sur eux, suivant au nez l’odeur de leurs transpirations. Camille plante les doigts écartés de ses deux mains à travers ses cheveux qu’elle ramène vers l’arrière. Des mèches restent collées à son visage, huileuses et gorgées de sueur.
Ils ont seize ans.
–“Sais-tu quoi, Léon?…” Elle glisse les deux pouces derrière les bretelles spaghetti de son justaucorps. Elle les étire un grand coup et les laisse aller claquer sur sa poitrine. “… j’adore l’été.”
Elle sort un vieux thermos Dunkin Donuts de son sac à dos, un gros vingt-quatre tasses. Elle dévisse la tasse puis le bouchon et prend une gorgée à même le goulot. Un liquide rouge et sirupeux déborde de chaque coin de ses lèvres et coule le long de son cou.
–“Calvaire,” gueule-t-elle, “Je viens de saloper mon fuck’n top.”
–“Je me rappelle de ma première cuite à ça, mais c’était tellement romantique,” que Léon ajoute avec un brin de sarcasme. Il allonge son bras vers le thermos, Camille lui frappe l’épaule d’un bon coup de poing.
–“Ça m’a tout l’air que tu vas être obligée de l’enlever, ton top” dit-il l’œil un peu brillant, comme si c’était la chose la plus intelligente à dire dans les circonstances.
Ce vin aux fruits particulièrement sucré était le hobby du frère de Camille. Une vieille recette de famille. Épais, davantage un sirop de framboises sauvages qu’un vin. Elle en fait gicler un long jet bien droit à travers la craque entre ses deux palettes, directement sur le ventre de Léon. La fin du jet est tombée comme une corde flasque et molle, tombée dans son cou à elle et sur son pauvre justaucorps déjà souillé.
–“T’aimerais trop ça les voir,” qu’elle lui répond en se pinçant les seins comme s’ils étaient des klaxons-poires.
Léon bombe le torse. Son ventre est dur et plat, son nombril en saillie a l’air d’un popcorn collé là. Camille se tient tout près de lui. Dans une direction, ils observent les éclairs de lumière rouge que font les cigarettes des gens qui s’embrassent dans les voitures plus loin. Dans l’autre direction, les lumières des remorques qui s’allument et s’éteignent par moments, les silhouettes sombres des gens du cirque qui animent les murs des roulottes. Ils observent au loin le spectacle de lumières psychédéliques au-dessus du cirque, le Zipper en néons violets, les lumières jaunes de la Fureur du Pharaon, le Marteau et ses faisceaux verts et bleu en alternance et la grande roue qui domine le spectacle dans une orgie de halos bleu-blanc-rouge clignotant en farandole.
…
Ils sont redescendus s’installer près de la grande roue un moment. Camille s’est offert la totale, une queue de castor avec de la crème fouettée, du sucre en poudre, du sirop au chocolat et une pluie de grenailles de bonbons de toutes sortes de couleur. Henri le clown assis sur sa chaise au-dessus d’une piscine transparente a crié à Léon qu’il avait de grandes oreilles et qu’il n’était bon qu’à aller faire de la lutte avec une vieille chèvre. Camille crampée de rire répète à Léon qu’il avait de grandes oreilles et qu’il n’était bon qu’à aller faire de la lutte avec une vieille chèvre. Une Jeannette en uniforme fait couler le pauvre clown à son premier lancer, les enfants agglutinés devant la piscine se tordent de rire. Léon s’offre une limonade, il en boit la moitié puis il mélange le reste avec le vin aux fruits. Pas tellement bon. Camille se colle serrée contre Léon sur leur banc. Lorsque la Jeannette coule Henri une seconde fois, il lui gueule au micro qu’il irait dire aux petits garçons les plus laids de son école qu’elle avait un kick sur eux.
Dans les chemins boueux couverts de foin entre les stands et les manèges ils se fraient une route dans la foule de familles en meutes serrées, des petits couples habillés pareil et des groupes d’adolescents survoltés. Lorsqu’ils aperçoivent le frère de Camille et sa bande de lurons en goguette, ils se faufilent à travers les toilettes chimiques et se sauvent vers le campement de la foire encore une fois. Puis vers la colline derrière.
–“Il en a pris pour combien?” demande Léon en pensant au frère de Camille.
–“Aucune idée, il passe devant le juge dans deux semaines.”
–“Oh.”
Léon se tient les épaules bien tirées vers l’arrière, le cou droit. Il prend une longue et virile lampée dans le thermos Dunkin Donuts, presqu’à s’en étouffer. Camille s’assoit sur le sable et prend une grande gorgée, elle aussi. Elle se remplit les joues et elle fait gicler le liquide entre ses lèvres. Du vin lui coule de la bouche, elle s’essuie avec ses mains. Le vin est encore descendu le long de son cou. Elle rit et le reste du liquide s’écoule malgré elle de sa bouche entrouverte.
–“T’es donc bien fuckée,” Léon lui dit et puis il vient s’assoir près d’elle. Elle lui passe le thermos. Il en prend une gorgée plus grosse qu’il ne l’avait d’abord imaginée, qu’il souffle au complet sur la poitrine de Camille. Il regarde le liquide descendre entre ses deux petits seins venir tacher encore plus sa camisole. Il se retourne rapidement et regarde ailleurs, troublé, lorsqu’il réalise que Camille semble gênée qu’il regarde sa poitrine. Sans réfléchir, il dit :
–“C’était juste pour prendre ma vengeance.”
Elle le repousse de ses deux mains dans un drôle de petit son que font ses doigts couverts de vin lorsqu’ils collent et se décollent des épaules de Léon. Elle recommence, écoute le drôle de son et rit. Elle s’extirpe du justaucorps imbibé, le tord comme une guenille, elle l’agite ensuite dans les airs comme un drapeau, comme pour l’aider à sécher.
–“Pourquoi on ne fait pas ça plus souvent?” qu’elle demande. Puis, un brin confuse, elle ajoute : “Je dis on, je veux dire un grand nous, pas juste toi et moi. Mais toi et moi aussi, je présume, on est un genre de nous, nous aussi.” Elle s’étend dans le sable et prend appui sur ses coudes et laisse sa tête plonger vers l’arrière comme un poids mort, ses cheveux qui traînent dans le sable. Elle arque subtilement le dos pour grossir sa poitrine nue.
–“Peut-être parce que la christ de foire vient juste une fois dans l’été,” répond Léon.
–“Ah et pis fuck la foire,” Camille avait la voix légèrement empâtée, “si c’était moi le patron, j’installerais toute la patente et je la ferais la plus lumineuse possible, la plus boucaneuse, brumeuse, effrayante comme elle est là, avec tous les cris et les bruits, les odeurs de gras et de sucre et je ne chargerais rien pour entrer mais je chargerais dix piastres pour venir s’assoir ici et la regarder de haut. D’ici, c’est beau en calvaire.”
Léon est inquiet. Il la regarde en plein dans les yeux. Son visage est étrange.
–“Léon, ciboire, ramène ta babine d’en bas rejoindre ta babine d’en haut. C’est pas comme si c’était la première fois que tu me vois pas de camisole, rien.”
–“Mpfff,” que Léon répond. Il détourne les yeux. Il tente de lancer son regard le plus loin d’elle que possible. “C’est pas poli,” qu’il dit, nerveux.
–“Qui ça, toi ou moi?”
Comme bien des filles de onzième année, Camille portait un parfum en vaporisateur qu’on pouvait trouver au nouveau centre d’achats, rempli de petits brillants. L’odeur du parfum avait pris le bord depuis longtemps mais toute la peau de son corps était encore comme une constellation brillante même sans la grosse lune. Léon remarque comment toute sa peau, sa poitrine spécialement, scintillent et comment le vin et la sueur tracent comme des rivières sur sa peau comme une carte géographique et comment des sédiments s’accumulent dans des drôles de recoins, comment les chemins contournent les belles courbes de son corps.
–“Depuis quand tu essaies d’être poli, Léon Santerre?”
–“Depuis quand tu as d’aussi jolis seins?” la seule stupidité qu’il trouve à lui répondre, mal à l’aise.
Camille se laisse tomber complètement sur le dos, les bras en croix. Elle fait un son bizarre comme Meuh. Ensuite, elle rote un grand coup.
–“Hello-o, toutes les femmes ont des seins, man, fuck. Rince-toi l’œil comme tu veux. C’est rien que de la peau.” Puis elle ajoute sur un ton beaucoup moins offusqué, “De toutes façons, ils sont tellement petits, alors proportionnellement parlant, tu as été rien qu’un peu impoli.”
Léon se laisse tomber sur le dos lui aussi.
–“J’en avais jamais vu une vraie paire sur une vraie fille avant.”
Camille pouffe de rire.
–“Tu pensais en voir une où d’autre que sur une fille, ciboire?”
Ils se rassoient et se regardent. Léon dit, “Tu sais ce que je veux dire.”
Les deux partent à rire en même temps. Camille donne un bon coup de poing sur l’épaule de Léon mais moins fort cette fois-ci. Camille était une joueuse de softball redoutable, elle frappait comme un garçon lorsqu’elle le voulait. C’est ce que les garçons lui avaient dit. Elle parle et regarde en même temps, le torse nu de Léon, son pantalon un peu descendu qui laisse voir une ligne de poils noirs courir vers son nombril en popcorn. C’est nouveau ça, pense-t-elle.
Elle dit, “Ça ne me dérange pas que tu regardes mes seins. Regarde tant que tu veux. Je te laisse les regarder parce que je les aime bien, moi, et j’aime bien que tu aimes bien les regarder toi aussi. J’aime ça quand tu me regardes.” Elle cherche du regard le thermos. Elle le retrouve, en prend proprement une gorgée cette fois-ci puis le passe à Léon. Il essaie de boire et de lui répondre en même temps.
–“Je n’aime pas ça, non, pas tant que ça en tous cas,” qu’il essaie de dire la bouche pleine.
Elle dit : “Merde au cul, Léon Santerre, va chier.”
Elle rajoute : “Et c’est quoi le chapiteau dans tes culottes?”
Léon rit mais redresse quand même ses genoux dans un effort pour rapetisser le chapiteau. “Fuck”.
–“Prends le temps de t’en remettre, mes grandes oreilles rien que bon qu’à aller faire de la lutte avec une vieille chèvre.” Elle se lève et part vers une benne mécanique derrière eux dans le chantier du Walmart. Elle grimpe dans le siège du chauffeur, baisse ses culottes et pisse sur le banc de cuirette. Lorsqu’elle est revenue Léon est debout, et calmé, il regarde vers le bas de la colline. Elle se colle sur lui, place sa main sur ses épaules.
–“Je ne sais vraiment pas ce qui serait la bonne chose à faire, qu’est-ce qui doit se passer maintenant,” dit Léon qui regarde les lumières de la foire au loin.
Le fond de l’air se fait plus cru sur la colline. Camille est couverte de chair de poule. Les mamelons de Léon sont comme des effaces neuves au bout d’un crayon de bois. Ceux de Camille aussi, en plus long.
“Il va pleuvoir,” n’importe quoi, Léon dit n’importe quoi.
“On va se baigner,” suggère Camille.
“Oh yeah!”
Ils piquent à travers le chantier et les lumières de la foire s’estompent derrière eux à mesure qu’ils redescendent sur l’autre versant. Certaines d’entre elles projettent de longs rayons jaunes et violets à travers les nuages, comme des rayons de soleil dans l’eau. Au bout du chantier, une petite grève de sable sur la crique où les gens vont pique-niquer, descendre leur kayak ou leur canot. Camille et Léon se retrouvent nus comme à leur première heure au bout de la pointe de sable léchée par un coude de la rivière, les orteils à la flotte déjà. Elle se retourne et se penche sans façon, histoire de pousser tous leurs vêtements dans son sac à dos. Elle se relève et part sur un sprint de l’enfer se jeter à l’eau. Elle disparaît momentanément sous l’eau comme une torpille, puis se relève, de l’eau à hauteur de taille, pour voir ce que fout Léon. En cambrant les reins, elle glisse ses cheveux vers son dos. Sa peau blanche prend une coloration bleutée lorsque la lumière d’une faible lune la frappe.
–“Arrête de regarder ma bite!” se plaint Léon, encore debout sur la grève, “est-ce que l’eau est froide?”
Elle crie : “De la vraie glace fraîche fondue!” avant de s’élancer à la renverse dans l’eau. Léon s’élance à son tour vers Camille.
–“Ou bien on est mieux dans l’eau que les fesses à l’air, ou bien je suis saoul,” dit Léon
–“Tu dois être saoul,” répond Camille, et ils pagaient avec les bras jusqu’à atteindre la limite, là où ils peuvent encore prendre pied et ne garder que la tête hors de l’eau. Léon se hisse sur le dos, Camille plonge et passe dessous.
–“Ça ressemble à avant, quand on était petits, quand mon père était encore vivant, quand il nous emmenait pique-niquer ici et ma mère finissait toujours par nous laver ensemble, tout nus, avant de nous rembarquer dans l’auto,” dit Camille. “Seulement, là on est saouls.”
–“Ça fait toute la différence.”
Camille se retourne et plonge vers l’avant. Pour un temps, seules ses deux fesses blanches sortent de l’eau avant de disparaître, ses deux pieds disparaissent les derniers en projetant un puissant jet d’eau sur Léon.
Elle remonte et Léon dit : “Tu m’as mooné, Camille Simard, j’ai vu tes fesses!”
–“J’ai essayé d’ouvrir mes yeux sous l’eau mais moi je n’ai pas pu rien voir,” répond Camille.
–“Tu fais dur!” dit Léon, intimidé.
Elle dit : “La petite quéquette des grandes oreilles rien que bon pour aller faire de la lutte avec une vieille chèvre a été avalée par ton nombril en popcorn?” et elle pouffe de rire.
–“Il fait juste trop noir, tu n’as pas pu voir, c’est tout.” Puis, fier comme un coq, Léon s’élance sur le dos en lançant de l’eau au visage de Camille avec ses pieds et se laisse flotter sur le dos devant elle, qu’elle zieute à son goût.
–“Wouash, as-tu vu la touffe de poils!” dit Camille.
–“Quoi, pas comme si t’en avais pas toi aussi!”
Il nage sur le dos vers elle et il attrape sa main. Elle lâche un petit cri et se sauve en arrosant le visage de Léon avec ses mains.
–“Ça, tu le sauras jamais!” Elle rit, elle nage, elle plonge encore. Elle refait surface plus loin, elle essaie de débarrasser l’eau de ses yeux avec ses mains. “J’aurais dû apporter plus de vin,” dit-elle l’air un peu bougonneuse.
Léon s’élance à son tour et en moins de deux il est debout près d’elle dans l’eau et sa main descend à la recherche du pubis de Camille. Ses doigts découvrent brièvement une texture drue et piquante. Elle dit : “Léon!” et elle n’a pas l’air de rigoler, “Je ne pense pas que je veux qu’on aille là.” Et elle se pousse hors de portée de Léon.
Il dit, “Oh.”
“Désolé,” dit-il, “qu’est-ce que j’ai fait de mal?”
–“Je ne sais pas, rien, je suppose.”
–“Je pensais que tu aimais que j’aime te regarder?”
–“Oui mais là, tu n’es plus juste là à essayer de me regarder.”
–“Excuse-moi, Camille.”
–“C’est pas grave, ça doit être le vin de mon frère, beaucoup trop sucré.”
Ils sont assis sur le sable, des pièces de vêtements déposés sur eux tiennent en place par la seule humidité de leurs corps détrempés. De rares gouttelettes de pluie mais grosses comme des billes commencent à tomber, les cercles de leur onde délicate fuit lentement sur la surface de l’eau, le silence commence à avoir envie de les suivre.
–“Pour qui tu t’es donné la peine de te raser dans ce coin-là?” demande Léon.
–“Personne,” dit-elle. “Pour moi, je ne sais pas.”
–“Pourquoi tu te rases, alors, si c’est pour personne ou si tu ne le sais pas.”
–“Parce que ça me tentait, Léon, c’est tout.”
–“Tu peux me le dire, ça ne me dérange pas,” demande Léon sur un ton nouveau.
–“Personne, je t’ai dit, Léon. Juste pour moi, je le voulais. Pourquoi ça te dérange? Qui ça dérange? Pourquoi ça te choque?”
–“Je ne suis pas fâché. Je veux juste comprendre.”
–“Tu n’as rien à comprendre, je n’ai rien à expliquer.”
–“Je pensais qu’on était amis depuis toujours, tu m’as toujours expliqué. Tant de choses que tu m’as expliquées.”
–“Arrête, Léon.”
–“As-tu déjà baisé avec quelqu’un?”
–“Ça te tenterais-tu qu’on en reparle une autre fois?”
–“Alors, tu l’as fait!”, accuse Léon.
–“Non, non. Je ne sais pas.”
–“Tu ne sais pas si tu as déjà baisé ou non?”
–“Léon.”
–“Je suis tellement stupide, tellement fuck’n stupide, excuse-moi, Camille.”
–“Tu n’es pas stupide –”
–“Tu m’as dit que je l’étais.”
–“Non, je n’ai jamais dit ça. C’est toi qui as dit ça.”
–“Alors, c’est ça, c‘est de mja faute à moi.”
–“C’est –”
Léon bondit sur ses pieds, il marche vers le sac de Camille retrouver le reste de ses vêtements. Il vire le sac à l’envers, prend les siens, tasse de côté ceux de Camille.
–“Léon.”
–“Je ne te reconnais plus, Camille, moi non plus d’ailleurs je ne me reconnais plus.” dit Léon avec une voix qui se met à craquer.
–“Tu ne vas pas t’en aller tout seul, comme ça, sous la pluie?”, se plaint Camille.
–“Oui, non, je ne le sais plus. Allez, on s’en va. Inquiète-toi pas, je ne te regarderai pas te rhabiller.”
–“Léon, calvaire, hostie que t’es pas juste avec moi.”
…
Il ne restait qu’une mince couche, des restants de temps entre eux et le matin bleu, et au matin clair, le soleil a brûlé les nuages qui avaient survécu à la nuit, fait fondre la bruine et la brume. La foire reprendrait lentement vie. Ils auraient remonté sur leurs bicyclettes, fait le chemin de chez eux jusqu’à la cour à scrap sous un soleil de plomb, se retrouver là où le frère de Camille et ses amis déjà éméchés seraient déjà à la tâche. Et à la fin de la journée, il leur tendrait chacun quelques billets à l’heure où les lucioles recommenceraient encore à se faire briller le derrière à travers les Pontiac, les vieux DeSoto et les F-150 bossés au point d’être irrécupérables.
…
Ils ont fait le chemin inverse, remonté puis redescendu la colline, marché à travers le chantier du Walmart, traversé sournoisement le campement des employés, traversé la foire déserte sans se faire voir, passé les guichets inhabités dans le noir, traversé la grande route depuis longtemps abandonnée par les voitures et le policier qui contrôlait la circulation. Une pluie pesante tombait drue maintenant jouant du tambour sur les manèges et les toits des remorques.
Une lumière jaunâtre vibrait par la pluie qui faisait grésiller les lampadaires à l’iode le long de la route et devant la cour à scrap. Les lampadaires se faisaient de plus en plus inutiles. La noirceur totale. Ils ont ramassé leurs bicyclettes et Camille marchait à côté de la sienne du côté de la route où se trouvait sa maison et Léon marchait à côté de la sienne dans l’autre direction, vers Roc d’Or.
–“C’était pour toi, sans dessin,” a cru entendre Léon au loin, à travers les grésillements et les feulements.
Avez-vous déjà entendu le feulement des lynx dans la nuit? On s’y méprendrait avec les lamentations des banshees, les fantômes des pécheresses bannies qui errent aux limites des cités et pleurent dans la nuit.
…
Le lendemain, le spectacle de tigres a été annulé. Apparemment dans la nuit, des garçons en goguette se sont introduits sur le site et se sont amusés à jouer au premier qui touche un tigre gagne une bière. La tigresse croyant ses petits en danger a attrapé le frère de Camille par le bras et lui a offert tout un tour de manège. C’est au prix de sa main, une partie de son bras, abandonnée à la gueule de la bête qu’il a pu fuir. Un homme, probablement un employé du cirque, a abattu le tigre qui mangeait paisiblement le bout de bras sans penser à se méfier. Un tigron s’est évadé en courant sous la pluie vers la grande route. Eut-il pris la direction du campement derrière, couru à travers le chantier du Walmart, gravi la colline, redescendu la colline vers la pointe de sable au bord de la crique, il aurait été enfin libre et heureux.
Aurait été. Un homme l’a abattu, lui aussi. Et la foire n’est jamais revenue à Malartic.
Les mouches à feu, elles, toujours.
Flying Bum