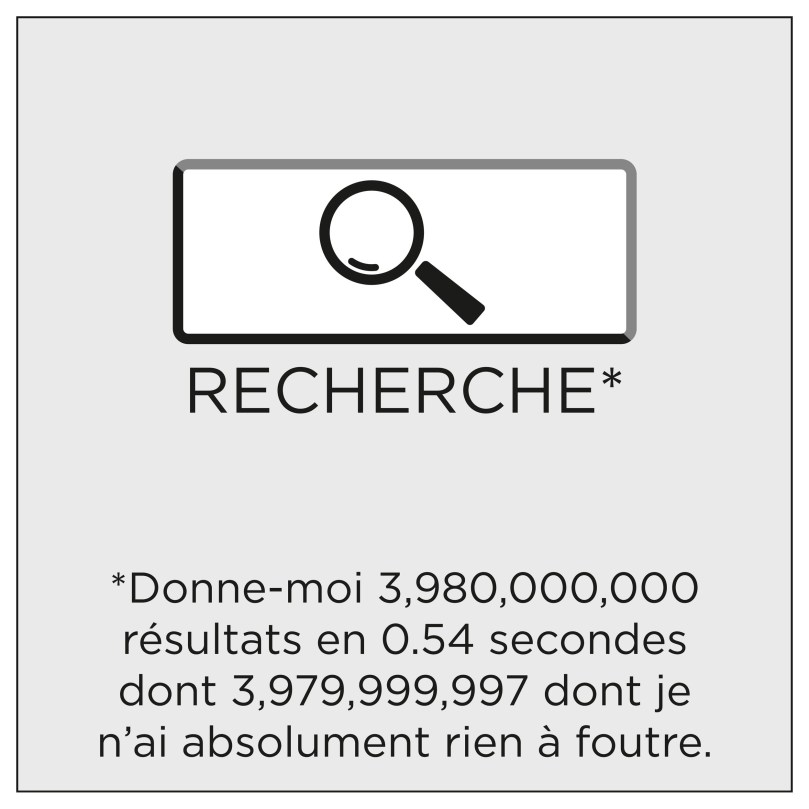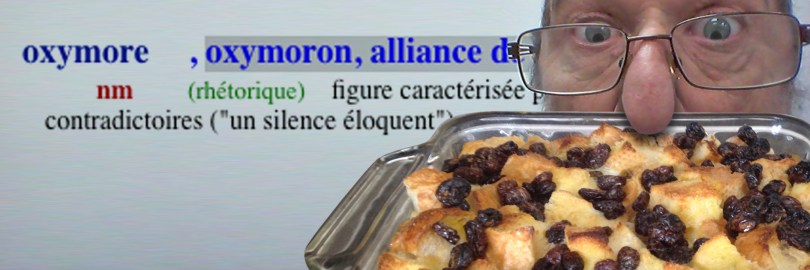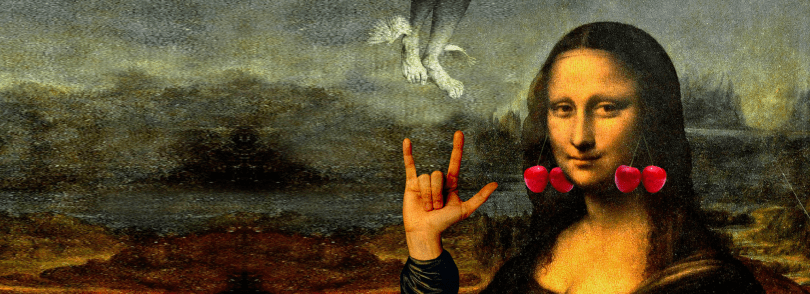Après avoir passé la plus grande partie de ma vie à enrichir les autres, j’avais maintenant ma propre petite affaire dans une ville de province et j’habitais la maison de mes rêves, tapie au fond des bois dans un recoin de Lanaudière. On sort facilement un homme des bois de l’Abitibi mais on ne sort pas aussi facilement les bois d’un homme d’Abitibi pour utiliser la formule éculée.
.
La maladie avait depuis belle lurette emporté ma première conjointe, mère de mes enfants. Quand même pas trop engourdi pour mon âge, j’avais trouvé quelques années plus tôt une femme merveilleuse en zigonnant sur les tout nouveaux réseaux sociaux, sous les bons conseils d’un vieil ami, et je l’avais emmenée dans le bois avec moi. La vie semblait enfin redevenir une expérience toute simple, apaisante et agréable. Mes deux fils étaient devenus des hommes et de bons pères de famille, j’avais gagné une fille au passage, j’étais donc devenu un grand-père cinq fois plutôt qu’une. Arrivant à la soixantaine, l’âge et l’expérience m’avaient permis de relativiser quelque peu mes ambitions professionnelles et je n’étais pas parti en fou dans cette nouvelle affaire comme cela m’était déjà arrivé dans le passé. J’avais déjà eu l’audace notamment de me lancer en affaires dans la crise économique du début des années 80 lorsque les taux d’intérêt avaient bondi à 18%, affaire qui avait particulièrement mal tourné à plusieurs points de vue.
.
J’ai toujours porté le coeur à gauche mais j’ai aussi un peu hérité de la maladie de mon défunt père qui échafaudait perpétuellement des plans de nègre de toutes sortes pour se repartir en business encore et encore. Tout ceci faisant que l’histoire de ma vie est jalonnée de contradictions pas toujours évidentes. Malheureusement ou heureusement c’est selon, j’ai toujours eu cette forte tendance à rêver la gueule grande ouverte et de quelquefois perdre contact avec certaines réalités jugées bêtement inintéressantes à mes yeux, mais une espèce de douce nonchalance philosophique qui me vient fort probablement de ma mère vient toujours comme contrebalancer le tout.
.
Au fil des ans, je m’étais construit un bon réseau de contacts dans le domaine de l’emballage et je poursuivais dans la même foulée en offrant mes services comme designer d’emballage, graphiste évidemment et j’avais aussi mis sur pied un petit atelier spécialisé dans la production de prototypes d’emballages. Cette dernière activité attirait une clientèle nouvelle, peu d’entreprises oeuvrant dans ce secteur précis dans la province et même au pays. J’avais développé au fil des ans une expertise très particulière dans l’impression des pellicules plastiques qui m’avait servi à monter un atelier somme toute assez unique en son genre. Un passage récent dans une grande foire commerciale m’avait permis de rencontrer plusieurs nouveaux prospects intéressants de la région de Toronto et j’y avais délégué un ami qui faisait de la représentation pour des fabricants d’emballage dans la région. Il avait bien voulu dégrossir le terrain pour moi, l’atelier me tenant relativement occupé. Mais ça mordait à la ligne et mon ami qui ne comprenait pas à fond tous les tenants et aboutissants de mon entreprise m’avait appelé en renfort, convaincu qu’avec ma présence on pourrait closer des bons deals. Comme il s’était déplacé dans la ville-reine en automobile, j’avais donc décidé d’aller l’y rejoindre en train. Mais j’avais aussi promis à mes petits-enfants d’aller courir l’Halloween avec eux, Toronto allait devoir attendre un jour ou deux. Sans aucune crainte du ridicule, je me suis donc affublé du plus stupide des costumes que j’avais patenté moi- même juste pour faire rigoler les enfants. Je suis allé passer l’Halloween comme convenu avec ma douce et les petits, chose que je n’avais pas faite depuis moult lunes et le lendemain, elle me déposait à la gare. L’âge m’avait effectivement calmé le gros nerf des affaires, mes priorités étaient maintenant organisées bien différemment qu’avant.
En prenant place dans mon wagon ce matin-là, j’ai réalisé que je n’avais pas pris le train depuis plus de 40 ans, à l’automne 1974 pour être précis.
…
Halloween 1974.
Je fixais le sol désespérément, d’où j’étais c’était tout ce que je pouvais voir, ça et mes deux pieds. Le terrazzo chamoiré du plancher me semblait animé d’étranges mouvements et me plongeait dans un état de vertige indescriptible et inconfortable. Beaucoup de consommations diverses contribuaient à ce malaise évident. La musique vrombissante sonnait sourd à travers la peau de vache en peluche dans laquelle j’étais englouti et la chaleur torride me faisait suer à mesure les quelques bières que j’avais pu boire quand la satanée vache cessait de parader pour un moment dans le café étudiant en pleine euphorie. Mon ami Claude et moi avions loué cet horrible costume de vache chez un costumier du vieux Montréal, costume qui exigeait deux opérateurs. “On va y aller chacun notre tour”, disait l’hostie de Généreux à marde. Mais en fin de compte, j’étais prisonnier dans le cul d’une vache depuis le tout début de la soirée. Claude était mon meilleur ami et à l’époque nous bambochions presque toujours ensemble, je ne lui aurais jamais tenu rigueur d’une niaiserie pareille, c’était un de ces soirs où tout était matière à rire.
.
Contrairement à moi, Claude ne supportait pas toutes les dopes à la mode et se contentait de la bonne bière. Nous nous complétions bien, moi c’était un peu l’inverse, l’alcool ne m’attirait pas spécialement. Mais en ce soir de party d’Halloween, le diable était aux vaches et il m’avait carrément oublié dans le derrière de celle-ci. Lui avait le beau jeu, une grande gueule pour respirer bien à l’aise, toutes les manettes pour actionner les ridicules grands cils de la bête, la gueule par en haut et par en bas et l’insupportable meuhhhh électronique qui sonnait la cacanne dont il abusait allègrement. Mais surtout, il avait l’avantage énorme de pouvoir rester debout. En arrière je devais rester plié en deux me tenant par les mains sur ses hanches pour me guider, une petite fenêtre grillagée aménagée dans l’abdomen de la bête pour regarder par terre et le dos commençait à m’élancer sérieusement.
.
Et puis les choses ont commencé à aller encore un peu plus mal avant d’aller mieux. Quelqu’un avait gaiement pris la vache comme monture et s’était ramassé sur mes épaules. J’avais maintenant une charge à supporter malgré moi. Une fille, selon toute vraisemblance. Le poids n’était quand même pas si important mais surtout, ce que je ressentais dans mon cou ne portait pas de pénis dans l’entre-jambe de toute évidence. Dans la noirceur d’un cul de vache, mon esprit adolescent rêvassait à l’idée d’avoir une chaude vulve qui se frottait sur mon cou au gré du mouvement. Et les choses ont soudainement pris une tournure singulière. La température s’est mise à chuter considérablement, le volume sonore à diminuer, la musique s’est éteinte graduellement. Je n’entendais plus que quelques rigolos qui s’amusaient ferme à déconner allègrement alentour de l’animal, des bruits de voiture en sourdine et j’ai commencé à apercevoir du ciment mouillé par la grille de la bedaine de vache, de l’asphalte, des feuilles mortes. La vache avait pris le champ! La rue, en fait. La vache et une rigolote escorte de clowns en tout genres cherchaient désespérément une épicerie licenciée dans les rues de Rosemont, le café étudiant venait de manquer de bière. Nous fêtions solide. L’Halloween d’une part mais aussi nous célébrions notre départ imminent. Claude et moi avions planifié rien de moins qu’un tour du monde en s’élançant d’abord vers l’ouest. Nous prenions le train dans les jours suivants pour nous rendre à Vancouver dans un premier temps. Nous avions souventes fois voyagé ensemble sur le pouce dans le Québec et dans l’Ontario mais la distance Montréal-Vancouver en auto-stop nous rebutait quelque peu, on voulait se donner un bon swing en partant, de là l’idée de se payer des billets sur le train trans-continental. Et nous n’aurons pas été les premiers ni les derniers innocents à s’élancer de la sorte à la conquête du monde et à finalement se cogner le nez sur l’océan Pacifique qui se parcourt très mal sans le sou et sur le pouce. On en retrouvait partout des innocents petits québécois sur la grève de l’île de Vancouver, faméliques les yeux dans le vague du Pacifique, l’esprit emporté par le légendaire champignon magique.
…
À cette époque précise, ma vie ne s’en allait strictement nulle part. J’avais quitté la maison paternelle, l’école du même coup devant pourvoir à ma subsistance à un âge plutôt précoce selon les critères d’aujourd’hui. J’avais loué un petit studio meublé au sous-sol d’un triplex de la huitième avenue qui était devenu l’after hour par excellence du toute l’amicale de Rosemont. Mes amis étaient pour la plupart des étudiants qui vivaient chez leurs parents, quelques intellectuels, de futurs brillants scientifiques ou ingénieurs, syndicalistes, politiciens, avocats, ou artistes qui suivaient l’air du temps tout simplement, vivant candidement leur bohème en attendant que leur vraie vie ne commence. La vraie mienne était bel et bien commencée, elle, modestement et tout de travers.
.
Pour rajouter au spleen, je m’étais désespérément amouraché de cette fille qui m’obnubilait et que je voyais dans ma soupe. Cela durait depuis au moins deux ans, tout remontait à la première fois où je l’avais vue, ce fut comme un sauvage bombardement ennemi sur mon coeur et j’y ai perdu tout mon génie sur le champ. Il existe bien pire que les atroces douleurs d’un amour à sens unique, je n’avais aucune espèce d’idée des sentiments que cette fille pouvait ressentir à mon égard. L’ignorance se faisait alors souffrance. Quatre décennies plus tard, j’ai encore plein de questions restées sans réponses. Cette adorable jeune fille avait réussi avec grande distinction son doctorat en confusion relationnelle. Peine perdue de tenter de déchiffrer ses sentiments réels et de voir clair dans son jeu. Nous nous croisions partout, fréquentant les mêmes lieux, et elle venait souvent chez moi socialiser à travers tous les habitués de la place et je forçais souvent la note pour me retrouver dans les mêmes lieux qu’elle, le plus près d’elle possible. La belle Nancy Donovan, jadis reine de beauté de Saint-François-Solano, me torturait le coeur comme un bourreau de première classe. Nous avions une relation des plus cordiale mais ambiguë au possible, on ne pouvait jamais savoir ce que cette fille pensait vraiment, ses dispositions illisibles même pour un oeil-de-lynx de la psychologie féminine comme mon ami Michel T devant lequel toutes les filles finissaient par tomber. On ne lui connaissait aucun béguin particulier mais plusieurs semblaient croire qu’elle leur était destinée, moi le premier. Sa gentillesse toute naturelle et son attitude trop avenante se prêtaient à toutes les interprétations selon les circonstances. Plusieurs fois je m’étais dit, ça y est, je suis l’élu! Mais chaque fois, dans la fraction de seconde qui suivait, sentant qu’elle s’était compromise davantage que de raison, elle me glissait des doigts comme une couleuvre. J’étais sur le point de m’en rendre malade. Tout ce que je possédais de crayons et de papiers étaient au service des odes à sa grâce et à sa beauté, en textes, en images, en prose, en poésie que je gribouillais à tout moment du jour et de la nuit. Quand je m’ennuyais d’elle profondément, elle disparaissait sans pitié pour un bon moment. Quand elle m’exaspérait totalement, elle apparaissait comme par magie, toute candide et souriante. Je devais tirer un trait et me guérir d’elle une fois pour toutes pour mon propre salut et ce voyage tombait fort à point pour soutenir mes efforts à sevrer mon coeur de cet amour impossible.
…
“Ti-Lou, tu t’achètes-tu de la bière?” entendis-je soudain du fond de mon trou de cul de vache. “Je voudrais bien mais délivrez-moi de la cavalière, quelqu’un.” Un grand garçon qu’on appelait affectueusement la zoune, sous les habits d’un zombie vomissant, se fit un plaisir d’aider la belle fermière à descendre de mon dos et je m’extirpai de ma fâcheuse position pour sortir me déplier au grand jour, au grand soir devrais-je plutôt dire. Je suis ensuite entré dans l’épicerie avec les autres et je me suis ramassé un six-packs d’O’Keefe. Et toute la rigolote compagnie se bidonnait de voir ma tronche sortir de son guet-apens de peluche, ma cavalière particulièrement amusée de découvrir enfin qui avait été sa victime. Déguisée en coquette fermière, elle s’était sentie toute pertinemment justifiée de grimper sur la pauvre vache et d’en abuser allègrement. Avec quelques picots sur les joues comme seul maquillage, tout le monde pouvait aisément la reconnaître. Son entre-jambes tout chaud avait eu raison de mon cou maintenant tordu par la douleur, on était rendu bien loin de mes doux fantasmes.
C’était Nancy Donovan en personne cette fermière. Merde, me dis-je alors, c’était vraiment un don spécial qu’elle avait de toujours apparaître dans ces moments-là.
…
Le progrès, c’était bien beau quand ça a commencé, disait mon père. Les trains avaient maintenant des connections wifi à bord. J’avais éteint le portable et le cellulaire pour me retremper dans cette sensation bénie qui m’envahit toujours quand mon corps se déplace dans l’espace, surtout quand personne ne sait vraiment où je suis précisément et que mon corps n’est plus qu’une masse à déplacer, sans utilité aucune. Ne reste que l’esprit vagabond qui vit. De Repentigny au centre-ville première étape, les wagons sentaient le neuf, je baptisais presque cette toute nouvelle ligne de trains qui reliait maintenant Mascouche au centre-ville de Montréal mais nous étions quand même très loin des splendeurs de l’Orient-Express malgré les scandaleux dépassements de coûts que cette nouvelle ligne ferroviaire avait engendrés. Dans cette ville que je pensais bien connaître par coeur, le train passait par des endroits que je n’avais tout de même jamais vus, des points de vue hors de la portée des trottoirs et des rues. Après une brève correspondance à la gare centrale, me voilà embarqué pour quelques heures vers la ville-reine. Quelques instants bénis de voyagement que j’ai toujours préféré occuper à rêvasser plutôt qu’à travailler comme les autres stressés qui faisaient le voyage dans ce même wagon. Le rêve éveillé est un passe-temps lénifiant pour l’esprit qui gagnerait à être pratiqué plus largement par les angoissés de ce monde, ils n’en seraient que plus allumés et efficaces le temps vraiment venu d’accomplir quoi que ce soit d’intelligent.
Tout de même magique comment notre odorat possède la capacité d’enregistrer et de garder en mémoire toutes les odeurs du passé. L’odeur particulière des gares, le diésel des engins dans l’air frais et humide, toutes des odeurs profondément inscrites en moi et qui sont revenues comme ça pour me ramener illico moult années en arrière, refaire momentanément de moi cet adolescent fébrile amorçant naïvement son tour du monde sur un quai de cette même gare. Et tout naturellement, cet embarquement de 1974, les interminables préparatifs, cette mémorable soirée d’Halloween et ces curieux coups de Jarnac du destin qui sont venus marquer les derniers jours ont rejailli des recoins lointains de ma cervelle et se projetaient comme un cinérama devant les yeux ébaubis de ma conscience en mouvance vers Toronto.
…
L’étrange procession avait quand même parcouru une distance respectable. Du collège rue Beaubien coin 16ème avenue, nous nous étions rendus à l’épicerie Lafond sur Dandurand! Si bien que tous n’étaient pas convaincus que la fête continuait toujours au collège étant donné qu’il n’y avait plus de bière là, qu’il se faisait tard vu que nous avions tout de même niaisé longuement dans les rues. Alors, il y eut comme une dispersion des troupes, quelques-uns ont pris une chance de retourner au collège, d’autres sont rentrés chez eux et une poignée d’habitués se sont dirigés vers leur after hour habituel, chez moi huitième et Bellechasse. Nancy nous y a suivis et d’autres sont venus nous y rejoindre plus tard. La fête a continué jusqu’à l’heure bleue lorsque quelques cadavres commencèrent à joncher les meilleures places de mon petit studio, le temps que les autobus ne reprennent du service et les ramènent chacun chez eux. Nancy qui ne voulait aucunement dormir parmi les corps morts m’a demandé si je voulais la raccompagner chez elle, à pieds on s’entend. Pourquoi moi, pensais-je? D’autres avant étaient retournés chez eux et auraient pu l’accommoder sans faire le moindre détour. Cela représentait une bonne marche pour des gens dans notre état mais je ne pouvais jamais lui refuser quoi que ce soit. Je me fis donc bon prince et nous sommes partis encore une fois par les rues de Rosemont. Elle avait passé sa main sous mon bras comme le font les vrais amants en me regardant d’un air tendre et en me faisant la grâce d’un ravissant sourire comme elle seule savait les faire, ce qui m’avait davantage troublé que ravi dans les circonstances. La fille n’allait quand même pas me tomber dans les bras au moment même où je partais sur un nowhere sans date de retour prévue, les billets achetés et payés! Elle avait le tour d’apparaître quand on ne l’attendait plus, comme le petit Arlequin qui sort d’une boîte à surprise recrinquée et qui surprend toujours les enfants même s’ils savent très bien qu’il en ressort toujours. J’étais maintenant rompu à ses étranges manoeuvres sentimentales et je me suis dit que ce n’était qu’un soir de même sans plus, une autre soirée à la Nancy.
En route elle me dit qu’elle ne pouvait pas croire que nous nous en allions Claude et moi, que ce ne serait plus pareil sans nous !?! Encore cette sale ambiguïté pénible et douloureuse. Elle n’a jamais dit plus pareil sans moi, ce qui m’aurait flatté et ragaillardi mes espérances sûrement, elle avait simplement dit sans nous. Et elle m’a demandé le plus simplement du monde si elle pouvait venir avec nous à Vancouver.
Ce qu’il me restait de genoux à cette heure-là de la nuit a plié d’un coup sec. Ma volonté n’était toujours qu’une vue de l’esprit nulle et non avenue devant toute demande qu’elle avait la magnanimité de bien vouloir m’adresser. J’allais devoir lui dire oui à mon corps défendant et traîner mon petit malheur avec moi partout autour du monde !?!
.
Coudon, comme chante le poête, a voula-tu m’tuer?
.
…
J’étais allé rejoindre mon ami Marc à l’hôtel où il m’avait réservé une chambre près de la sienne en face de l’aéroport Pearson. Marc était un représentant qui travaillait à son compte pour divers fabricants et distributeurs de produits d’emballage. Je l’avais connu par le biais de mon associé qui utilisait ses services sur une base régulière et il avait bien voulu collaborer avec moi. Comme bien des représentants, Marc était d’un entregent hors du commun, de très agréable compagnie, et ses connaissances en plasturgie constituaient pour moi un atout précieux. Un homme avec une intéressante et inépuisable conversation mais pas exactement le genre party animal. En voyage d’affaires, il était homme à se replier dans ses quartiers assez promptement, peu porté sur l’alcool et davantage concentré sur les affaires. Un homme de famille, un couche-tôt.
.
Rien à voir avec les voyages d’affaires totalement fous que je faisais jadis avec Michel Malorni qui attirait comme un aimant, partout où on allait même dans les pires recoins du Wisconsin, des cohortes de belles femmes sorties d’on ne sait où. Pour Michel, la vie en voyage n’était rien d’autre qu’un grand buffet à volonté à tous les égards, le budget du plaisir sans limites. Mais, grand bien me fasse, je m’étais également calmé considérablement le bozarlo depuis belle lurette à ce chapitre, la sagesse nous prenant d’assaut sans pitié avec les années. Après un souper somme toute assez agréable dans une brasserie torontoise à regarder les Maple Leafs se faire battre lamentablement par les Hurricanes de la Caroline, nous sommes directement rentrés à l’hôtel et bonsoir la compagnie. J’avais absorbé une bonne quantité de vin rouge, aucune aide de Marc pour finir la dernière bouteille, il était notre chauffeur. J’ai bamboché un peu dans le complexe hôtelier et je suis finalement monté à ma chambre, ouvert une bouteille de rouge du mini-bar et je suis sorti sur le balcon prendre une bouffée d’air de Toronto, le temps étant spécialement doux pour cette période de l’année.
.
Nous étions directement en face de l’aéroport. Je pouvais observer les avions atterrir et décoller dans le ciel rose et mauve de cette nuit d’automne. Une chorégraphie de machines d’acier dessinée très serrée meublait le ciel de Toronto, leur vaste scène au sol décorée de milliers de lumières alignées bien droites jusqu’à l’horizon, scintillantes et clignotantes comme dans les plus heureux Noël. Le vin plutôt triste, l’âme demeurée en mode voyagements et le corps bien engourdi sur mon balcon, j’enviais tous ces étrangers que la mouvance emportait on ne sait où. Une tenace mélancolie me collait au corps. Je me rappelais la fois où nous regardions paisiblement décoller les avions Michel et moi à Dallas et que les haut-parleurs hurlaient nos noms dans un anglais de patate chaude et que nous ne bougions même pas un peu, tellement le sale accent massacrait nos noms. Et mon baptême du sud, la fois où Denise et moi étions descendus à pied directement sur la piste de Port-au-Prince et qu’une chaleur étoufante nous avait complètement pris par surprise, suffoqués mais ébaubis du contraste après un embarquement à Mirabel à moins 35; la fois où ma douce a fait son baptême de l’air à elle en route pour Miami, paniquée comme une enfant qui attend son tour pour aller dans les grandes montagnes russes pour la première fois de sa vie. Une fois à Chicago, de retour d’être allé fumer au diable vert dans le seul 4 pouces carrés autorisé à cette fin, une énorme femme noire amputée du sourire, en uniforme et armée jusqu’aux dents, m’avait demandé mon passeport et en lui tendant, je lui avais fait remarquer à quel point je ressemblais à Ben Laden sur la photo, pas ma meilleure blague à date. Ou la fois où Claude et moi regardions décoller les avions à Dorval et qu’il me pointait celle-ci ou celle-là en commentant leurs caractéristiques et qu’il m’en pointait une qui était exactement comme celle qu’il s’en venait prendre. Le drame étant que nous regardions béatement décoller celle-là même dans laquelle il devait monter.
.
À l’image de tous ces gens que les grands oiseaux d’acier emportent avec eux, le temps fuit à la vitesse grand V quand nous remontent à l’esprit tous ces souvenirs. Qu’il emporte avec lui toutes ces bonnes gens qui ont tissé des grands morceaux de nos vies et qui continuent de squatter nos pensées.
.
J’étais là dans cette grande métropole à y placer mes jetons dans des conditions idéales, j’avais monté ma petite entreprise dans des conditions de rêve qui auraient fait baver d’envie le jeune entrepreneur impétueux mais sans le sou que j’avais déjà été, j’avais construit une niche quasi sans concurrents, les pronostics étaient des plus optimistes et pourtant. Je ruminais là, sur ce triste balcon d’hôtel, pour la première fois fort probablement, le bilan de tout ce parcours. Sans même le réaliser, sans même l’avoir planifié, c’était surgi tout seul de mon esprit trop aviné comme une bulle d’air qui s’arrache mollement du fond vaseux pour remonter tranquillement en se dandinant à la surface du marais.
.
Le temps ne fuit pas devant nous comme on en est convaincu toute notre vie durant. Prétentieux de croire à ces sornettes à la tempus fugit. Le temps se fout de nous, il n’en a rien à branler de fuir devant nous. Il s’amuse à nous rattraper par derrière, tout simplement, en se payant nos vies sans jamais perdre son sinistre sourire. Et nous courons toutes nos vies devant lui sans jamais gagner la moindre avance. Vient un temps où il faut définitivement se faire violence et essayer d’autres ruses de sioux pour sauver notre misérable peau. Louvoyer, ralentir, respirer calmement, faire exactement comme si l’ennemi ne nous effrayait plus et espérer le regarder du coin de l’oeil nous dépasser et nous oublier là dans la confusion.
.
Sur ce balcon de Toronto seul avec mon rouge, j’ai eu le goût de tout abandonner et de me fondre à tous ces étrangers en mouvance perpétuelle, m’envoler vers nulle part rien dans les poches comme dans le train de Vancouver.
Et c’est précisément là, ce soir-là, que j’ai été vieux pour la première fois de ma vie, vieux et seul.
.
Courtyard Marriott brillait dans sa jolie police de caractères classiques sur l’enseigne lumineuse flambant neuve tout juste à côté de mon balcon. Drink to me Marriott, s’tie, fis-je en lui levant mon dernier verre.
.
…
Les lettres de néon usées de la vieille enseigne art déco parvenaient encore à allumer sur le boîtier de tôle à la peinture toute craquelée, directement devant ma fenêtre. Et les mots s’imprimaient distordus pour s’effacer aussitôt le temps d’un battement de cils puis revenaient se projeter sur le mur défraîchi de ma chambre. Clarence Hotel clignotait l’enseigne, incessamment toute la nuit durant. On se serait cru dans un vieux polar des années 30. Hôtel bâti en 1894 selon les registres de Vancouver, le Clarence faisait tout le coin Seymour et Pender dans la partie du centre- ville où à l’époque vous n’auriez pas envoyé votre fille se promener seule, même en plein jour. Par les journées de grandes brumes opaques, quand celles-ci s’abattaient sans prévenir, on pouvait entendre tous les grillages tomber dans un fracas de tôle et d’acier pour protéger les vitrines des commerces plus bas sur Hastings et sur Cordova et quelques fois, le fracas du verre quand les malfaisants gagnaient de vitesse les pauvres commerçants et les pillaient sans vergogne protégés par l’opacité des grands brouillards. Les beaux jours de cet hôtel étaient définitivement derrière lui et ce quartier avait accumulé un déficit d’amour important à force de négligence. Le Clarence était un des quelques établissements qui acceptaient les coupons de l’aide sociale et recevait à coucher tous les parias détenteurs de l’heureux coupon tant fut-il qu’ils étaient des hommes. Un homme par chambre, couvre-feu à respecter, tranquillité obligée. Claude avait ses appartements un peu plus loin sur le même étage, un immense 50 pieds carrés comme moi, un lit simple à barreaux de métal, une chaise bancale, un petit lavabo en coin, toilettes à l’étage sans cloison entre les cuvettes. On y chiait en famille.
.
Nancy habitait au St-Francis plus bas sur Seymour. Même principe, cet établissement hébergeait les jeunes filles et les femmes détentrices de coupons de l’aide sociale. Impossible pour moi de décrire l’intérieur des lieux, la matrone qui protégeait l’entrée possédait un sens de l’humour qui se comparerait à celui de la trappe à ours. La bonne femme avait davantage de barbe que tous les poils que moi et Claude aurions pu avoir où que ce soit à l’époque, un coeur de hyène dans un corps de cachalot échoué dans le triste lobby. Aucun individu mâle ne franchissait cette créature du diable. Pour ma lune de miel à Vancouver avec miss Saint-François-Solano, vous vous trompez d’histoire pas rien qu’un peu. Le tour du monde ne tournait pas exactement comme prévu.
…
La carcasse de la vache était échouée dans un coin perdu de mon petit studio que j’avais abandonné à mon frère le temps de faire le tour du monde. Claude et moi avions décidé que le costumier devrait se contenter du dépôt que nous lui avions versé et faire son deuil de l’horrible mammifère de peluche et du reste du paiement. De toutes façons, nous avions tant et tellement de fois fêté notre départ que le chiche budget de voyage imposait maintenant ce genre de choix. Jusqu’à la dernière minute, j’étais resté convaincu que Nancy ne se présenterait jamais au départ. Elle habitait encore chez ses parents et pour ce que j’en savais, son père, un homme d’une certaine sévérité, ne laisserait jamais partir sa fille avec deux hurluberlus pour un voyage pareil. On parle d’un homme qui avait trois portraits magnifiquement encadrés ornant les murs de sa salle à dîner : John F. Kennedy, la reine Élisabeth et Jean XXIII. Mais elle était toute là, en chair et en os, lorsque nous avons monté dans le train à la gare centrale. Même si mon pouls avait atteint un sommet historique en la voyant, le moins que l’on puisse dire c’est que je m’embarquais avec le coeur rempli de sentiments ambigüs et l’esprit noyé dans les questionnements profonds. Le mystère entourant sa décision de partir avec nous n’avait pas été résolu bien que j’y jonglais presque jour et nuit. Tout ceci me troublait beaucoup plus que l’idée de partir comme ça au loin avec une toute petite poignée de dollars en poche. Claude avait accepté de bon gré qu’elle se joigne à notre projet sans s’interroger davantage. Alors, en voiture les amis, la terre entière nous attendait!
.
À l’époque il existait deux lignes trans-continentales. Le Canadien Pacifique avait la sienne au sud qui passait notamment par Calgary et Banf et le Canadien National exploitait la ligne du nord, celle-là même qui est toujours en opération et qui passe par Edmonton et Jasper. C’est cette dernière que nous avions choisie parce qu’elle traversait les Rocheuses de jour. Trois nuits et quatre jours avec le CP contre quatre nuits et trois jours avec le CN. Nous avions pris la classe économique il va sans dire, sans wagon-lit.
.
Nous passions le plus clair de notre temps assis sur les banquettes du coach, wagon pour passagers de classe économique muni de sièges seulement, et nous y dormions également en s’y contorsionnant, cherchant sans fin le confort là où on ne le trouverait jamais finalement exception faite des rares petites joies lorsque la belle Nancy dormait comme un ange la tête blottie au creux de mon épaule, mieux, carrément allongée sur mes cuisses. Une réelle intimité était chose impossible dans ce drôle de ménage à trois. Pas de belles salles à dîner pour nous non plus, budget oblige, et nos présences dans le bar du dome-car étaient également comptées. La nourriture de la cantine des pauvres était hors de prix malgré sa piètre qualité et la petitesse des portions. Si bien que lorsque le train s’est arrêté une première fois à Winnipeg après le long calvaire du nord de l’Ontario, nous nous étions précipités dehors à la recherche de la première épicerie pour faire des provisions à prix raisonnable.
.
Nous commencions déjà à ressentir sévèrement l’insouciance avec laquelle nous avions dépensé en festivités et en futilités avant d’embarquer, les réserves de liquidité se faisaient maintenant plutôt sèches. À l’escale de Winnipeg un passager très singulier était monté à bord. Un riche cultivateur du Manitoba qui venait tout juste d’en finir avec sa saison agricole. Il avait probablement reçu un énorme chèque de Kellog’s ou de je ne sais quel gros acheteur de céréales, le monsieur avait besoin d’un Cessna pour aller au bout de ses terres et en revenir dans la même journée! Chaque année après les récoltes, rituellement, il montait dans ce train rejoindre sa soeur et sa mère installées à Vancouver, prenait place dans le bar du dome-car et payait tournée après tournée à qui voulait bien l’écouter se vanter de ses richesses et de l’immensité de ses exploitations et ce jusqu’au bout du voyage. Nous nous sommes donc nourris à la bière et aux peanuts de bar une bonne partie du voyage tant qu’on y servait les clients et tant que les oreilles ne nous tournaient pas en choux-fleurs à force d’écouter les forfanteries de l’homme totalement imbu de lui-même.
.
Arrivés à Vancouver, nous étions déjà pratiquement sans le sou. Nous nous sommes immédiatement précipités au bureau de l’aide sociale où on nous a gentiment remis des coupons pour manger et pour nous offrir des places à coucher. Pour obtenir quelque somme que ce soit, il nous fallait une adresse fixe à tout prix, alors va pour les coupons le temps que nous trouvions un travail quelconque et qu’on s’installe quelque part. Claude et moi étions des habitués du mode survie et les choses ne se passaient pas nécessairement comme prévu certes, mais nous étions encore loin du mode panique, notre périple commençait à peine. Nous ne vivions cependant pas tous cette expérience avec un égal bonheur. Pour la jeune fille qui nous accompagnait et qui avait quitté le confort de la maison paternelle pour la première fois de sa vie, tout ceci n’était pas sans générer une bonne dose d’angoisse.
.
Claude et moi avions éprouvé beaucoup de plaisir à découvrir Vancouver et nous poussions l’insouciance jusqu’à à jouer aux touristes malgré tout, abusant sans gêne des titres de transport gratuits que nous avait remis le bureau de la main d’oeuvre, titres qu’on devait utiliser pour notre recherche d’emploi. Mais le soir quand nous revenions dans les tristes quartiers du bas de la ville de Vancouver où se trouvaient les cafétérias qui acceptaient nos coupons-repas et les hôtels qui faisaient de même pour nos chambres, et toute leurs clientèles de parias, quand nous allions reconduire Nancy au St-Francis, on pouvait lire l’angoisse et même la peur sur son visage. Cette situation m’attristait considérablement mais il fallait tous prendre notre mal en patience et essayer de voir venir en toute sérénité.
…
Où se trouve aujourd’hui le Sinclair Center au coin de Granville et de West Hastings, se trouvait à l’époque un vaste édifice propriété du gouvernement fédéral. Magnifique bâtiment de style baroque edwardien, l’atrium central d’une hauteur impressionnante accueillait un comptoir postal, premier grand bureau de poste du vieux centre-ville. De majestueux guichets aux barreaux de bronze et aux comptoirs de marbre d’un côté et dans le centre se trouvaient de grands comptoirs ouvragés dans les bois les plus nobles où les clients pouvaient s’installer et préparer leur courrier, ouvrir ou préparer leurs colis, compléter des formulaires et toute cette sorte de choses. Nous nous y étions rendus pour nous inscrire à la poste restante de façon à pouvoir éventuellement recevoir du courrier. L’aide sociale nous avait demandé de faire la démonstration que nous n’étions pas éligible à l’assurance-chômage, nous avions donc besoin d’une adresse postale. Nous avions des formulaires à compléter et nous nous étions installés sur un des comptoirs au centre de l’immense hall. Claude et moi étions d’un côté et Nancy de l’autre et directement à mes côtés se trouvait une religieuse en uniforme et en cornette qui devait bien friser les 140 ans. La vieille dame avait de toute évidence beaucoup d’affaires à régler au bureau de poste à en juger par la façon dont elle s’était étalée sur le comptoir. Papiers, cahiers, enveloppes, sacs, il y en avait partout et elle zigonnait d’une pile à l’autre, écrivait, cachetait, léchait des enveloppes, faisait des piles. Son bazar s’approchait tranquillement de mon espace à mesure qu’elle s’affairait de façon tout à fait désordonnée à ses petites tâches. À un moment, elle souleva une pile de papiers près de moi dévoilant son porte-monnaie, posé et oublié là. Je voyais des beaux billets du dominion qui dépassaient par le repli de la maroquinerie de cuir verni. J’ai ressenti comme une petite absence de génie, je jure que ces billets s’adressaient à moi personnellement. J’ai agi sans même réfléchir ne serait-ce qu’un peu. J’ai déposé nonchalamment un formulaire sur le porte-monnaie de la bonne soeur et tout en faisant l’innocent, j’ai attendu un certain temps une réaction qui n’est jamais venue. Elle continuait à picocher dans ses affaires comme si de rien n’était. J’ai tiré le formulaire vers moi, le porte-monnaie dissimulé dessous qui a suivi par le fait même. En levant le bon coin du formulaire, j’ai sorti les billets prestement et repoussé innocemment le tout à sa place. Ni Claude à qui mon corps cachait la vue, ni Nancy directement en face de moi n’ont soupçonné la moindre chose. Voilà qui illustre de brillante façon le fameux dicton, l’occasion fit de moi tout un larron, me voilà à voler une fille du bon Dieu! J’ai dû prendre une centaine de dollars à la nonne en uniforme mais ce fût là la seule et unique fois que j’ai volé qui que ce soit, Allah m’en soit témoin. J’avais considéré le plus sérieusement du monde et même pris Dieu à témoin que nous en avions davantage besoin qu’elle.
.
Je devais trouver une façon de réconforter la belle Nancy qui en avait maintenant plus qu’assez de la petite misère et qui parlait déjà de rentrer à la maison après seulement 4 jours de ce régime. Avec mon larcin, nous sommes allés dans un quartier plus décent nous offrir un vrai restaurant payé avec de la vraie argent, pas de coupons, pas de parias, rien. La chose nous fût bénéfique et d’un grand réconfort. Nous avons tellement bien mangé, longuement et gaiement discuté. Bien rigolé en se régalant comme des riches jusqu’au dessert avant de finalement l’accompagner là où elle voulait maintenant aller.
.
Reprendre le train pour Montréal.
…
Clarence Hotel me clignotait dans la face sans fin. J’avais retourné la chaise et je l’avais placée devant la fenêtre même si mon regard ne visait plus que la noirceur et le vide. Monté à califourchon, les coudes bien appuyés sur le dossier, le menton calé sur le revers de mes mains je regardais dehors, le coeur complètement détruit, son cordon qui pendait misérablement jusqu’au plancher sale. Toute l’énergie que j’avais déployée à rester composé d’un seul morceau à la gare était maintenant disparue et une lassitude profonde m’envahissait. L’impression tenace et puissante que le destin venait de me faire dans les mains, que ma vie venait de prendre un tournant significatif, que je venais de manquer un gros virage et de prendre le champ. D’être tombé dans un trou noir sans fond.
.
Elle était partie.
.
Sur le quai de la gare, le poids des derniers instants m’avait écrasé sur place. Je laissais Claude faire tout le small talk de circonstance, les mots m’étouffaient la gorge avant même de pouvoir en sortir, alors peine perdue, je fermais ma gueule et j’écoutais. Nous n’étions pas des amoureux, elle ne me devait rien, elle s’en allait comme elle était venue sans autre histoire ni promesse. Mais le moment pesait sur elle aussi, on pouvait le sentir. Au son du dernier appel, après deux petits baisers de cousin sur ses joues rouges à exploser, elle s’était ravisée. Elle s’est approchée de moi, elle a inséré les doigts de ses deux mains dans mes longues boucles et elle m’a déposé un tout petit baiser humide et chaud sur la bouche, juste assez mouillé pour éteindre mes espoirs à jamais. Une demi-seconde de cent ans sans bouger, ses yeux dans les miens, puis elle s’est retournée sèchement pour s’engouffrer dans le wagon.
.
Plusieurs en rient mais toutes ces chansons larmoyantes de cowboys qui abandonnent leur amour sur un quai de gare, toutes de la plus insignifiante à la mieux ficelée, celles à trois accords ou celles aux grandes orchestrations, les savantes comme les cucues me tirent encore des larmes à ce jour, larmes qui descendent tout droit de cette fin d’après-midi d’automne à la gare de Vancouver. Tellement de questions seront restées sans réponses comme autant de brûlantes grafignes sur mon coeur.
…
Dans la pénombre plus bas, dans le petit square de l’autre côté de la rue Pender, je pouvais distinguer dans le noir les visages des gens que le feu allumait brièvement d’un rouge reflet les uns à la suite des autres, le temps de prendre chacun leur touche. On s’y passait le thaï stick tour à tour. Les rouleuses que je fumais une après l’autre à la fenêtre prenaient soudain un goût bien fadasse et je salivais à m’imaginer le goût épicé de la drogue divine en pensée, je pouvais presque sentir son bonheur envahir mes veines. Mon coeur détruit en mille miettes réclamait haut et fort à mon esprit cet exil narcotique pour tenter de refermer sa plaie béante, calmer la douleur des spasmes du coeur. Et l’exil doré était tout juste là, de l’autre côté de la rue, je le voyais.
.
C’était notre dernière nuit au Clarence et à Vancouver. Nous avions décidé Claude et moi de jouer le tout pour le tout et de partir pour Victoria poursuivre ce périple. Et le périple allait durer encore plusieurs mois et nous permettre de voir des lieux à la beauté innommable, de rencontrer des gens hors du commun et de vivre des expériences fascinantes. Pire que deux frères, nous mettions toutes nos ressources en commun, Claude n’aurait pas compris que je gaspille nos rares ressources à sortir engourdir ma peine d’amour avec les tôqueux de Pender Square.
.
Je n’en étais pas à un deuil près cette nuit-là et la force m’est venue je ne sais d’où de rester dans cette misérable chambre et de lever à froid le drap blanc sur le visage de cet amour mort-né, une fois pour toutes. C’est dans cette nuit d’automne maussade et pluvieuse dans les bas-fonds de mon coeur et ceux de Vancouver, sous les néons clignotants du Clarence Hotel que j’ai pris une première dure décision d’homme. Je ne suis pas descendu me geler la gueule avec les tôqueux.
.
Ce soir-là, j’ai abandonné dans cette misérable chambrette mon adolescence et toute son innocence.
.
Drink to me, belle Nancy, stie!
.
…
Endroit de rêve s’il en est un pour venir déposer un cadavre. Cette nouvelle ligne de train avait coûté des tribillions de plus que prévu, livrée des siècles après les échéanciers initiaux et la gare de Repentigny n’était qu’une plate-forme livrée aux quatres vents, coiffée par endroits seulement d’une marquise de plexiglass, sans abri chauffé, sans guichet, sans restaurant, téléphone, rien. Et au beau milieu de nulle part sous un sinistre tronçon sombre de la 40 avec comme seule vie environnante une cour à bois fermée à cette heure-ci. Bien dissemblable de la moindre petite gare de banlieue de Toronto que je venais de voir, toutes équipées minimalement d’un guichet, d’un Starbuk Café ou d’un Tim, d’une tabagie. Je m’y gelais le cul carrément, seul avec moi-même, maugréant tous les sales mots du monde en y attendant ma douce que j’avais appelée au secours et qui ne tarderait plus à arriver maintenant. Il devait faire moins 80 avec le facteur vent et le facteur what the fuck combinés.
.
Après cette petite virée à Toronto plutôt fructueuse d’un point de vue des affaires mais éprouvante au chapitre des états d’âme, j’étais revenu dans de bien meilleures dispositions que je ne l’aurais espéré. Tout le long du trajet de retour, j’avais eu tout le temps de cogiter. Le bercement du wagon de me remémorer cet autre retour à Montréal bien des années auparavant.
…
Deux bonnes années s’étaient écoulées depuis. J’étais revenu de Vancouver et la vie joyeuse avait repris tranquillement ses droits. J’avais quitté le petit studio de la huitième pour un quatre-et-demi du vieux Rosemont et je revoyais toujours les mêmes amis. Sauf la belle Nancy que je n’avais pas revue depuis mon retour. Mon ami René m’avait invité un soir à la piaule de la rue Clark où on faisait formellement la fête sous un prétexte que j’ai malheureusement oublié. Des amis qu’on appelait la gang de l’ouest parce qu’exilés de Rosemont, avaient loué cette immense piaule dans le Mile-End. Quelques-uns y habitaient à demeure et plusieurs autres cotisaient au loyer pour y avoir droit à une planque à fesses ou un endroit pour aller socialiser en-dehors du giron familial. J’attendais toujours qu’on m’y invite formellement parce que je ne cotisais pas dans cette aventure ayant mon propre appartement à Rosemont.
.
J’étais encore célibataire à l’époque et une des filles de cette gang de l’ouest ne me laissait pas complètement indifférent, début de flirt tout au plus, alors j’acceptai l’invitation dans le vague espoir qu’elle y soit. En entrant dans ce qui était la salle à manger, lieu central de la piaule, je vis Nancy. Elle était là attablée avec plusieurs autres à refaire le monde. Elle a tourné la tête, m’a vu de toute évidence, puis elle a retourné la tête et poursuivi la conversation avec ses compagnons de table. Je ne l’avais pas revue depuis mais ce bref échange m’avait laissé dans un état plutôt indifférent, à tout le moins perplexe. Je cherchais déjà des yeux cet autre visage pour lequel j’étais venu.
.
Elle semblait encore fonctionner exactement comme avant, mon indifférence l’avait probablement contrariée. Plus tard dans la même soirée elle me cherchait d’une pièce à l’autre puis elle m’a trouvé et elle est venue m’adresser directement une demande surprenante. “Est-ce que je peux rentrer avec toi après la soirée?”, me demanda- t-elle sans autre préambule. J’avais acheté une bagnole moitié-moitié avec mon ami Michel T, on était voisins et on s’échangeait la petite voiture au fil des besoins, j’étais d’ailleurs venu dans l’ouest en automobile ce soir-là. “Bien sûr”, lui dis-je, ne sachant pas vraiment où elle habitait maintenant. “Où est-ce que tu veux que je te dépose?” lui demandai-je le plus naturellement du monde quand nous sommes montés dans la voiture.
.
“Chez vous, innocent!” fit-elle du tac au tac.
.
Ishhhhhhhh. Elle était toujours aussi belle, peut-être même un peu plus avec une certaine maturité qui était venue la transformer de belle façon. Et mon prospect ne s’était pas présentée à la soirée. Je venais de mettre ma main dans un engrenage terrible, pensais-je alors. L’idée de la ramener à la maison me faisait autant d’envie que de chagrin sincère. J’étais déchiré. Mauvais timing, nos vies avaient définitivement pris des chemins différents sur un quai de gare de Vancouver, rien ne pourrait jamais plus nous remettre sur la même route, j’en étais alors convaincu, j’en étais guéri. Pourquoi était-elle là? Le remords ou les regrets? À la quête d’un pardon payé au prix de sa chair? Juste pour du bon vieux sexe hygiénique? La doctoresse en confusion sentimentale frappait encore, et frappait fort.
.
J’avais l’opportunité unique de prendre une autre belle décision d’homme, rien ne militait en faveur du succès d’une rencontre pareille. Mais quand la chair est faible, hostie que la chair est faible. Cette nuit-là j’ai appris une grande et triste leçon. On ne guérit pas de cette façon nos vieilles blessures même si la sirène chante haut et fort, rien de bon ne pouvait se produire dans de telles circonstances et c’est exactement ce qui s’est produit. Rien de bon.
.
Après des ébats gauches, tristes et misérables, elle avait quand même décidé de finir la nuit chez moi, on achève bien les chevaux. Elle a dormi toute cette nuit blottie contre moi dans un lourd silence. Au matin, sans avoir à piller une religieuse en cornette, je l’ai emmenée déjeuner au chic Miss Masson, célèbre greasy spoon de l’époque sur la rue Masson. Et nous n’avons eu besoin d’aucun bec de cousin ni de baiser chaud et humide pour réaliser que c’était là notre ultime adieu, l’adieu de trop. La lourdeur de l’ambiance faisait la conversation à elle seule. Et je ne l’ai jamais revue.
.
L’implacable passage du temps a depuis transformé cette douleur qui a longtemps ulcéré les replis ridés de mon coeur en douce petite tendresse qui a valu à la belle Nancy son siège à bord de mon coeur pour le reste du voyage, jusqu’au bout de la ligne. Drôle quand même comment la vie peut se payer notre gueule de toutes les façons. C’est au Miss Masson que je regardais partir pour la dernière fois la belle Miss Saint-François-Solano qui m’avait tant et tellement massacré le coeur.
…
Sur l’express Toronto-Montréal, j’avais pris le temps de bien terminer toutes ces profondes réflexions amorcées par un soir de brouillard mental sur un balcon d’hôtel de Toronto et de remettre toutes ces choses en contexte. Après tout, pensais-je en traversant le pont ferroviaire longeant le pont de Charlemagne, la vie n’était plus aussi mesquine avec moi qu’elle l’avait déjà été. Ma nature profonde m’empêchera probablement toujours de cesser toute activité pour de bon, d’arrêter d’entreprendre toutes sortes d’initiatives, de partir sur des plans de nègre aussi variés qu’insensés parfois. Et le hasard fait bien les choses, je m’y soumettrai sans problème parce que j’aime profondément cette vie telle qu’elle est et telle qu’elle fût. Faire et créer, tirer moult choses du néant m’allume encore et toujours. La retraite, très peu pour moi finalement, le hamster tournera jusqu’au dernier tour de roulette. Mais je n’ai rien contre l’idée de bien prendre le temps qu’il faut pour faire toutes choses, pour bien aimer et apprécier les miens et les autres. Défier le temps n’est-il pas notre seul salut?
.
Je voyais maintenant au loin arriver la Honda Civic de ma douce et mon coeur s’emballait comme au premier jour. En prenant place au chaud dans sa voiture, lorsqu’elle me vit l’allure elle a bien ri. La connaissant, elle n’allait quand même pas se priver de l’occasion de se payer totalement ma vieille gueule tremblotante qui se la gelait aux frais de l’ATM dans cette gare digne du Twilight Zone, la moustache blanche de frimas sous mon nez violet et dégoulinant. La joie de me narguer lui transpirait de partout mais elle me ramenait tout de même là où toutes les choses étaient maintenant douces à vivre, où je pouvais regarder le temps me dépasser stupidement, respirer le parfum d’humus de mon bois, y courir avec ma trolley de petits, me remémorer toutes ces choses, les plus douces comme les plus douloureuses et pourquoi pas, être vieux bien d’autres fois encore et encore, avec elle.
.
Flying Bum
.