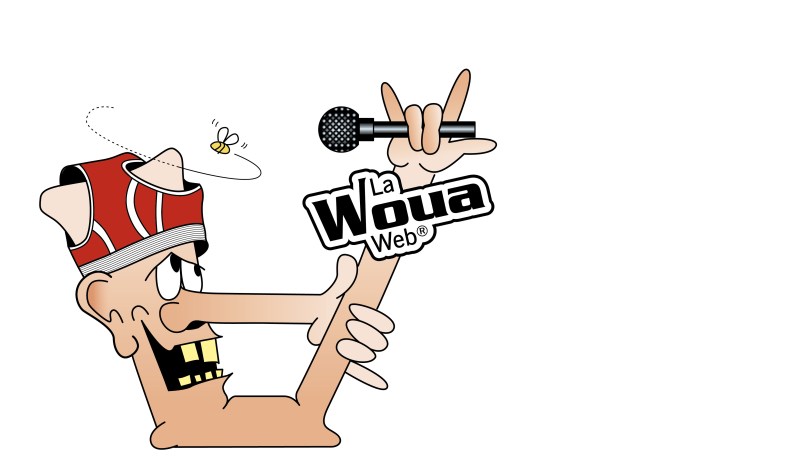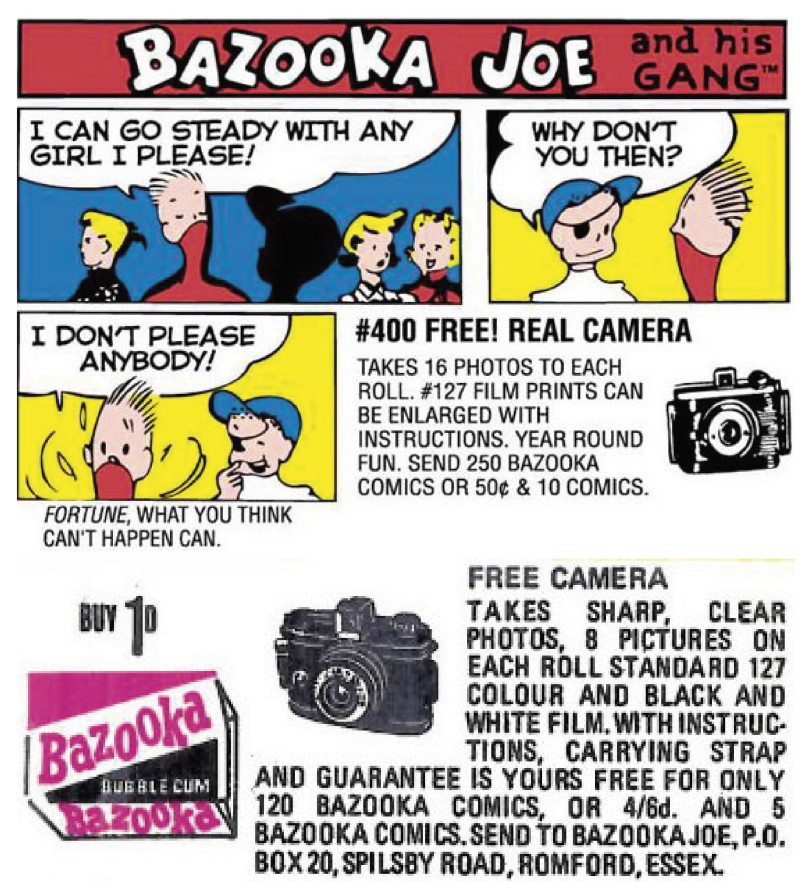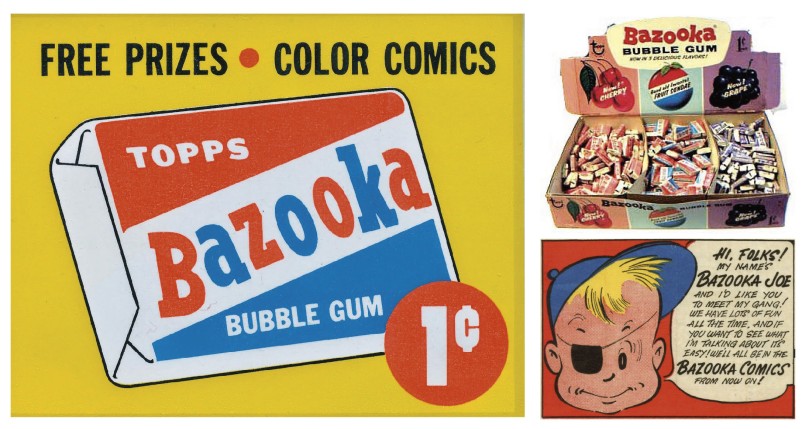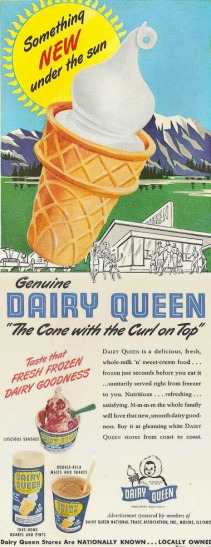Relever le dossier de ma chaise, facile avec la gueule, même à grands coups de pieds ça veut pas, je vais réveiller tout le monde.
Une nouvelle zone de turbulence en vue. Les autorités aéroportuaires auraient dû savoir, on ne déplace pas un mastodonte de cette ampleur sans risque. Des gens pourraient y laisser leur peau, d’autres leurs dos, y perdre leurs nerfs ou se les re-coincer. On parle d’un frigo de huit tonnes et demi, pas surprenant que les roulettes aient creusé un sillon de quatre pouces dans la dalle de béton de la salle de jeux. J’en pisse encore de la colonne. Mes prières sont désormais ma seule stratégie de pilotage. Le plafond nuageux est à trois pieds du sol, je marche penché, impossible à déplier. Impossible de bien piloter sous influence cet appareil incongru, un foutu lazy-boy beige et brun bon marché que ma douce avait trouvé bien de son goût. Une chance qu’on l’a tout de même, je ne déplie plus assez pour dormir dans mon lit. Mais la bête est combative. Veut pas se redresser.
Est-ce que j’ai bien pris toutes mes pilules? LONGUEUIL!, m’écriai-je à moi-même pour toute réponse. On dirait que oui. Quelle heure est-il, cou’donc? LONGUEUIL, encore!
La douleur s’amplifie au moindre choc, le pilote cherche désespérément à placer l’appareil dans la trajectoire-soulagement, les interrupteurs sur la position Ouf!, mais le tableau de bord a besoin d’un redémarrage on dirait, les appareils de vol virevoltent dans tous les sens, étourdis. La clanche ne répond plus aux coups de pieds carabinés. Comment redresser le dossier? Comment je vais me rappeler de tout ça si je m’endors dans ma sueur, épuisé?
La chaise, ah, la chaise. Dans la télé Monique Miller qui doit bien avoir cent ans marmonnait à Rousseau qu’elle a mis une année complète à apprendre un Ionesco par coeur, la chaise justement, juste parce que ça ne tient pas debout. Effectivement, moi non plus. Mille mots, je devrais me rappeler. Me forcer du moins. Même si on nage dans l’amphigouri le plus opaque. L’exemple que le dictionnaire donne pour l’amphigouri est formel:
— Alors, comment est-il ce matin le docteur ?
— Il est sauvé, mais il faudra qu’il redescende de son arbre à fous…
Mais non, ma tête est bien là, mais l’arbre? On a remplacé l’arbre qui s’égrenait tranquillement pas vite sur le plancher du salon par une étagère depuis belle lurette, ses restes dorment en bonne partie dans l’aspirateur central. Rien à craindre pour la folie comme telle, je suis bien calé dans le lazy-boy de ma douce, vol de nuit tout à fait féérique au-dessus de Longueuil. Tout baigne.
On fait le tour vite, quand même, dans un appareil de cette puissance. De Longueuil. Et on tourne et on tourne mais jamais on ne s’endort vraiment avec le souvenir d’un tel réfrigérateur coincé entre la vertèbre S1 et le bassin versant du boyau de jardin que je tentais de ressusciter d’un hiver trop long dans son petit cagibi dans le mur derrière le coupable électroménager.
Ça parle fort. Les gens s’agitent, ils n’étaient pas partis se coucher les “gens”? Ils ne travaillent pas demain, les “gens”? Mais qui sont ces « gens »? Ferme la télé, tu dors.
Moi en tous cas je ne ris plus, non, c’est décidé, demain je m’écrase me disais-je. Pas de bureau, il y a suffisamment d’affaires qui se brassent ici-même. Quand soudain rien ne voulait plus se calmer, soudain cette énorme turbulence comme un choc jusqu’aux orteils qui frappaient la chaise violemment pour que le dossier se redresse, mon appareil balloté comme un manège du Parc Belmont, mes lunettes, mon cellulaire, ma bouteille d’eau volent au-dessus de ma tête. Heureusement que le cellulaire était branché au chargeur sinon le cosmos l’absorbait et me laissait sans voie de communication avec le sol, la terre, avec Laurie qui dort toujours près du sien dans la chambre au loin.
Calvaire, l’étagère va me tomber dessus, je vais mourir étouffé sous cent-cinquante tonnes de bandes dessinées, on ne rit plus. Les hôtesses, les agents de bord, les waitress d’avions, les préposé(e)s de cabine au confort des passagers(ères) ne savent plus comment on doit les appeler ni où donner de la tête, ils courent partout comme des têtes pas de poule, s’accrochent qui à un siège qui à ses vaines espérances.
“Brace, brace!” hurle le capitaine dans les haut-parleurs dans un français très approximatif à mon goût à moi. Jamais je ne mettrai la tête entre les genoux, jamais, mon physiothérapeute a été formel. Mon fils Julien dit qu’il n’y a rien de scientifique là-dedans, que c’est la partie du manuel de sécurité aérienne qui fait acte de compassion; en pareille position, le cou casse sec, pas de souffrance inutile. Moi je veux voir. Dans mon hublot, pour une fois que j’en ai un, je regarde l’aile qui me semble sortie tout droit d’un Dali, pendouillante, molle. Étrange, on peut toujours assez bien prononcer molle, même la bouche molle. Molle. Molle-molle. Guacamole.
Une chance que je suis venu seul, les autres ne sont pas venus finalement, sans Fidel, c’est plus pareil Cuba. Venues non plus. Les femmes, je veux dire. Pas possible, tout de même, la nature est faite forte. Est-ce là une timide turgescence qui se dessine au loin sur mon pyjama malgré la catastrophe annoncée, calvaire! Non, ce n’est pas une érection, l’ultime de son genre s’il en fût une, c’est l’image de la mort qui se pointe la tête. Pas encore elle, une tache celle-là, la mort. Je lui ai pourtant dit que je la trouverais bien le jour où j’aurai besoin d’elle. Je vais enfin savoir si elle sort de nous à la fin, si elle fuit, ou si elle y entre définitivement, s’empare de la viande comme on se garroche sur le rôti en spécial quand le commis fait tomber de nouveaux paquets dans le comptoir vide chez Super C.
La vie nous vient des femmes, on peut se fier là-dessus, une femme. Mais la mort vient de partout, elle, la pas fiable. Les pieds m’enflent démesurément dans le sud à Cuba comme ailleurs, elle suit mes orteils dans le sable, me cherche même en vacances. Mais elle ne me fait pas peur, plusieurs de mes amis ou de ma famille sont déjà des morts et ils sont tous tout à fait inoffensifs. Mais elle m’enquiquine la vache, elle m’exaspère profondément. Tant qu’à être là à jaser avec le monde, à voir, à goûter, à sentir, à écouter, à voir pousser nos petits-enfants, qu’est-ce qui pressait tant que ça ce soir, la mort?
Mais la descente continue infiniment droite, linéaire, inébranlable, elle. Malgré le chaos qui règne ici-dedans. Secondes interminables qui ralentissent le temps pour nous laisser savourer chaque instant d’angoisse et de frayeur comme un dernier verre levé sur nos vies qui s’arrêteront au bout d’une sublime accélération de 9.7 mètres à la seconde carrée. Comme la grande côte du vieux cynique du Parc Belmont mais trois planètes de haut, pas de rail en bas.
La finitude, le néant. Une autre belle saloperie, le temps, quand ça arrête sec. Et la promesse se réalise en un choc assourdissant, opéra de crissements de tôle, de craquements d’objets désormais sans objet et de voix criant le dernier cri, râlant le decrescendo de la dernière mesure du dernier mouvement, boucane, pleurs, gémissements, lumières en folies déréglées, ramassis de morceaux d’avion et de chair humaine, même un foutu bichon maltais sorti de la soute, brassés dans les airs, facile comme une salsa dans le robot culinaire. Le sang qui me gicle des entrailles va-t-il emporter la vie avec lui au dehors de mon corps ou faire une petite place en-dedans de moi pour la mort qui veut s’y installer, je vais enfin savoir.
Le pouls devenu irrégulier, difficile à suivre mais toujours là, comme un tempo à la Frank Zappa et le chant des sirènes timides au loin, je prête l’oreille qui semble encore tenir à ma tête malgré tout, la douleur court de la fesse aux orteils à la fesse et encore comme autant de coups de poignards. Je me concentre, des petits pas au loin comme si la mort ne voulait réveiller personne, sur le bout des pieds. Il me reste assez de pouls pour les entendre s’approcher, la voix des sirènes s’emporte. Dominic qui marche sur la tête pour ne pas déranger la mort à six heures du matin, le secouriste, que dis-je, l’ambulancier maintenant. “Dis-moi ton nom.” LONGUEUIL! “Ta date de naissance.” LONGUEUIL! “Niaise pas, là, l’ambulance s’en vient. Quelle date on est, c’est qui le premier ministre? Non, c’est pas Claude Généreux.” J’ai entendu l’hélicoptère descendre en arrière de la balançoire, je dois avoir un pied de l’autre bord certain, un hélicoptère c’est pas rien. Si les ailes accrochent les moustiquaires de la balançoire, Laurie va tous les tuer, leurs brancards ne repartiront pas bredouilles, oh que non. Pas eux autres qui vont être obligés d’endurer les mouches après ça.
Dominic court à la porte leur ouvrir puis disparaît dans la cabine avertir les autres: “Mesdames et messieurs nous arrivons à Montréal-Trudeau où la température atteint 48 degrés Celcius dans une sinistre nuit sans lune. Veuillez relever le dossier de votre siège (facile avec la gueule) et rester assis jusqu’à l’arrêt complet de l’appareil. Merci d’avoir choisi Air Longueuil pour votre voyage et nous espérons vous revoir bientôt sur nos lignes.”
Ça réveille bête surtout quand on ne dormait pas.
Longueuil toute tranquille dans l’heure bleue où les fous promènent leurs chiens imaginaires en parlant à leurs reflets dans les vitrines éteintes. Un silence de cinq heures du matin dans le bois immobile.
Dans le salon chez moi, un clic tout p’tit, tout p’tit, la clanche a accroché.
Le dossier s’est redressé.
Flying Bum

À l’obscur chercheur qui a découvert l’acide (S)-6-méthoxy-α-méthyl-2-naphthalèneacétique (naproxène), reste à fignoler la posologie.