L’image est encore bien nette. La chambre à fournaise avec les monstres qui l’habitaient constituait le haut-lieu de toutes mes terreurs d’enfant. Deux petits bonhommes pas plus hauts que trois pommes, droits et immobiles s’y tenaient ce matin-là, moi et mon frère Marc. J’avais cinq ans à peine, lui six. Les yeux ronds comme les gros cinquante cennes en argent que mon oncle Aurèle nous donnait pour nos beaux bulletins, nous observions fascinés chaque geste de mon oncle Michel qui s’occupait à faire l’entretien annuel de la machine infernale. Celle-là même qui avalait du mazout et qui se remplissait la gueule de feu à longueur d’hiver dans un terrifiant vrombissement qui me paralysait sur place chaque fois que son moteur partait. C’est tout de même ce monstre qui nous gardait au chaud pendant tous les longs hivers abitibiens, une bonne bête dans le fond.
Mon oncle Michel était plombier à la mine Sullivan, l’homme tout indiqué pour ce sale mais utile boulot surtout que mon père était rarement intéressé aux choses de ce genre, rarement à la maison quand ces petits boulots devenaient nécessaires. Bien gréé avec sa salopette bleue et son beau coffre d’outil qui nous fascinait, il avait sorti d’un autre coin de la cave la grosse balayeuse Hoover, monstre de chrome et d’acier peint au faux-fini marbré bleu-gris, grosse patente domestique sortie tout droit des fastes années 50, tellement lourde que ma mère ne l’utilisait jamais. Ma mère n’était déjà pas des plus frotteuse, la vadrouille faisait très bien l’affaire pour elle. Juste le son de la Hoover quand mon oncle Michel l’a allumée, on aurait cru qu’un hydravion essayait de passer par le châssis de cave. Derrière elle où nous nous tenions, la chose crachait un jet d’air chaud malodorant qui nous peignait le toupet par en arrière pendant que du bout d’un long tube rattaché à la machine, l’oncle extirpait la suie noire de la bouche du monstre. C’est la grosse poche de la Hoover presque pleine à ras-bord que l’opération s’est conclue.
Quand l’oncle Michel a éteint la machine et qu’il s’est retourné, il avait le visage noir de suie, comme un ramoneur. La mémoire est une bien curieuse chose qui s’amuse perpétuellement à nos dépens. Il y a plus de cinquante ans de cela mais chaque fois que je m’imagine le visage crotté d’un pauvre mineur qui remonte d’une dure journée au fond d’une mine, c’est exactement cette image-là que mon cerveau tordu me fait rejouer, le visage de mon oncle Michel pour toujours dans mon esprit, prêté à tous les mineurs inconnus de la terre.
…
Curieux tout de même comment notre mémoire fonctionne, la mienne à tout le moins. On dit qu’à force de se répéter des histoires, on finit par y croire. Qu’à force de nier les choses, elles s’effacent du passé momentanément mais qu’elles reviennent toujours nous grimper au visage comme des loutres enragées, encore plus déchaînées. Ou à force d’avoir sa propre manière de se remémorer les choses, un ordre particulier dans lequel on dispose les faits, comment se raboutent les instants choisis au caprice, les détails qui nous accrochent et ceux qu’on oublie, pire, ceux qu’on veut oublier. L’histoire se déconstruit, se reconstruit au gré de nos humeurs. Elle s’écrit d’abord comme on la croit puis on en vient à croire les écrits à mesure que disparaissent leurs acteurs vivants. Il me reste bien peu de souvenirs de ma mère qui est morte la journée même où je terminais ma deuxième année. Certains sont flous. Certains, j’en suis convaincu, n’existent que dans la narration que m’en ont faite les autres, dans les rares photographies d’elle qui existent encore. Tout cela dans ma petite tête d’éternel rêveur se perd un peu dans le flou artistique de mon imaginaire. D’autres sont pourtant si puissants, indélibiles, indéniables autant qu’inoubliables. Des instants découpés au scalpel à travers l’épiderme du temps, un mot qui chante sans fin dans ma tête, un regard, un sourire, un frisson malaisant. Des instants auxquels on s’accroche, rares, précieux. Et d’autres qui ne sont que résurgences furtives et sans visage qui viennent et qui vont dans le fin fond de nos émotions et dont on ignore, sans savoir la raison même, la source, la finalité. Et nous n’en sommes pas moins chavirés. Entre l’âge X où la conscience s’allume et la fin d’une deuxième année B, les instants ne sauraient être si nombreux à attendre que mon esprit se les rappelle, me les raconte, m’en projette de belles images claires en noir et blanc, me replonge dans mes hier lumineux, me ramène son beau visage angélique de mère aimante qui au contraire du mien, ne vieillit plus jamais. Je lui ressemblais tant et voilà qu’elle prend les traits de mes enfants. Le temps qui n’arrête plus de tout repousser par en arrière, même elle, son âge figé là. On m’a dit qu’on pouvait éventuellement insérer deux ou trois éternités dans l’espace d’une nanoseconde, c’est un pouvoir qui nous viendrait avec l’âge pour compenser l’abandon forcé de nos vieilles prétentions d’éternité. Je voudrais tellement écrire toute une vie dans ce bref moment où le destin me laissait encore marcher dans ses pas, l’un avec l’autre vivants. Il doit bien exister des tribizillions de tristesses différentes racontées de tribizillions de façons différentes dans des tribizillions de langages différents et pourtant toutes vécues dans une seule et même nanoseconde éteinte depuis des lunes. Et ces coups de grisou qui noircissent la mémoire me reviennent sans cesse à travers les dentelles de caprice qui enveloppent ma tête de linotte, une hypocrite fumée d’orgueil qui me fait couler des yeux, l’estomac noué de couleuvres musclées, le souffle raccourci, le coeur noir de suie.
…
Cette année-là, deux grandes cabales électorales s’étaient succédées. Au printemps 62, John Diefenbaker faisait élire par la peau des fesses un gouvernement conservateur minoritaire au parlement canadien. Le grand héros de mon père et fort probablement de toute l’Abitibi d’où il était originaire, l’homme du peuple, Réal Caouette était à l’origine de l’élection de 26 députés créditistes au Québec sous la bannière de l’Union des Électeurs du chef Thompson. Mon père jubilait carrément. Puis en novembre, des élections provinciales se sont tenues opposant Daniel Johnson le bleu et Jean Lesage le rouge. Dans mes yeux d’enfants, la politique provinciale se résumait à cette étrange chose bicolore, bleue et rouge. Et pourquoi deux pouvoirs? Pourquoi devait-on avoir deux gouvernances alors que même un chien bâtard ne pouvait avoir qu’un seul maître?
Du haut de mes cinq ans et frais diplômé de première année, toutes ces choses-là m’indifféraient encore totalement dans le fond. La politique n’était pour moi que source de bruyantes esclandres dans les soirées familiales où les oncles s’engueulaient comme des faux frères et où les tantes finissaient par devoir mettre toutes leurs énergies à refermer le couvercle sur leurs marmites de maris avant qu’ils n’en viennent aux coups. Ils se rabattaient alors sur des histoires de mines ou de sport, de hockey en particulier, et leurs natures gueulardes reprenaient le dessus de plus belle. Chassez le naturel …
À cette époque lointaine, la plupart des mères pour ne pas dire toutes les mères étaient ce que l’on appelle maintenant des mères au foyer. Le jour, les maisons de ma rue étaient habitées essentiellement par ces femmes et leurs enfants. La huitième, un petit bout de rue, une quinzaine de maisons de chaque côté, coincée entre le boulevard Dennison et le crique à marde, le bois plus loin. Tout le monde s’y connaissait avec des accointances variables. Aujourd’hui, ma rue porte le nom du Curé-Roy, celui-là même qui était notre curé bien vivant à l’époque et pour lequel mon frère Doris a longtemps chanté la messe. Notre rue, ancien cul-de-sac comme un petit chapelet de maisons déposées là, débouchait depuis peu au-delà du crique à marde par la magie d’une calvette de béton déposée sans façon sur le lit du crique puis enterrée d’un voyage de gravelle et elle rejoignait un chemin de sable jaune qui partait vers Fatima au loin.
Les familles étaient généralement nombreuses et les enfants qui jouaient tout le temps dehors se soumettaient sans discernement aux ordres de toutes et chacune de ces mères qui veillaient en comité informel sur la discipline de tout ce petit territoire. Tous, nous étions les enfants de toutes ces mères qui régissaient les leurs comme les autres en attendant que les pères reviennent le soir. Le mien ne rentrait que tard l’automne, occupé à prospecter l’Abitibi à la recherche du filon d’or. Et ma mère n’était pas de celles à appliquer une discipline des plus zélée. Elle avait fréquenté l’école normale, nom qu’on donnait à l’époque aux écoles de filles de niveau secondaire, et c’était une chose plutôt rare à l’époque qu’une fille soit aussi instruite. Elle tenait fort probablement son indépendance d’esprit de cette éducation supérieure. Chez nous, la discipline était plutôt dandinante, l’éveil précoce de l’esprit et la bienvaillance à la limite nonchalante d’une mère que d’aucuns affublaient du qualificatif de mère-poule modulaient le savoir-vivre en famille davantage que la règle stricte. Il y avait comme deux familles chez nous. Les petits, mon frère Marc et moi, et les grands, Doris, Alain et Réal, pas de fille. Une dizaine d’années séparaient les deux groupes, années marquées par quelques fausses couches et la venue d’une soeur qui n’a pas survécu très longtemps. On n’empêchait pas la famille comme on le disait alors, advienne que pourra.
Dans ce petit univers, dans chaque maison, une histoire particulière. Certaines abritaient des familles venues des vieux pays ou de leurs descendances, toutes personnes attirées en Abitibi par l’essor des mines et répondant au manque de main-d’oeuvre minière ou à la grande liberté promise par cette contrée flambant neuve où l’utopie n’énervait personne. Lithuaniens, polonais, ukrainiens, russes, des anglais d’Angleterre, de rares français de France. Des orthodoxes, des protestants, des catholiques comme nous. Des familles d’ici venues des quatre coins de la province, du pays. Quelques rares maisons où ne vivaient pas d’enfants, trop grands et partis faire leur vie ailleurs, ou bêtement abandonnés tout petits dans les vieux pays, ou kidnappés par le bonhomme sept heures. Ou d’autres encore, leurs carcasses à moitié mangées par les loups-garous enterrées quelque part dans le bois. Il fallait absolument une raison précise dans mon esprit juvénile en ébullition pour qu’une maison n’abrite pas d’enfants, quitte à broder un peu. Et naturellement, ce sont ces maisons-là qui me fascinaient et qui attiraient toute ma curiosité. Sachant ces maisons habitées de jour par des femmes seules, il m’arrivait de me faire charmant enfant et de déployer toutes les ruses de sioux pour y être accueilli, en avoir le coeur net. Et contre toute attente, j’avais fini par avoir mes entrées dans plusieurs de ces antres à mystère. Je comptais moultes madames d’un certain âge parmi mes amies d’enfance et implicitement plusieurs de ces amitiés particulières se drapaient de la plus grande discrétion. Du moins ce qui se passait quand j’étais à l’intérieur de ces maisons restait dans ces maisons pour de bon. Souventes fois, que des gestes de candeur naïve d’une madame Rutkyz qui n’a jamais pu mettre bas et qui s’offrait en cachette la joie de catiner pour vrai, pour ne citer qu’un tristounet exemple, mais des choses bien mieux et aussi des bien pires qui réclamaient à hauts cris le plus grand des silences.
En cette fin d’été 1962, mon père parti dans le bois, ma mère seule à la maison avec sa trolley avait donné son nom pour travailler aux listes électorales. Un petit revenu supplémentaire, l’occasion de sortir de son trou, d’aller éventer ses puces dehors, d’aller sentir dans les autres maisons, je ne sais trop. Ce travail impliquait qu’elle parte faire du porte-à-porte pour noter sur un grand formulaire les noms de tous les voteurs qualifiés qui se trouvaient dans chaque maison sur sa liste. Les grands étaient rarement à la maison de jour, chacun ayant un petit boulot pour l’été ou alors quelque coup de Jarnac à faire en ville ou dans le bois. Pour une première fois dans mes souvenirs, la maison nous avait été abandonnée à moi et à mon frère Marc, contre un chapelet de petites promesses. N’ouvrir à personne, rester dans la maison, être bien sages, toutes promesses acquiescées en stéréo, sans conviction, du bout de la gueule dans un piaillement de petits oui-oui.
…
Mes souvenirs premiers, toutes ces vieilles images auxquelles je m’accroche encore et encore et les autres que je recherche sans savoir après quoi je cours. Mon histoire originelle n’est qu’une limbe immense, quintessence du vide, du non-être, du temps suspendu jusqu’au jugement dernier, tant soit-il qu’un seul de ces moments mérite l’éternité. Les temps forts, les instants marquants, s’incrustent et survivent à jamais; pour les insignifiances, l’ordre ou la séquence des choses ne comptent plus, la clarté de l’image vient en option. La seule logique qui tienne, je viens comme tous les autres de ce temps passé et ce temps passé fuit loin de moi, par en arrière, chaque jour depuis le premier jour. Toute cette amorce de vie comme un blanc de mémoire ne serait qu’un autel que je réserve à ma mère, pour une messe qu’elle seule pourrait me chanter. Je viens bien d’elle mais encore de ce pays nommé Abitibi et si sa forêt fût un jour mon jardin, ses feux m’ont jadis appris la terreur, son froid a fendu au sang ma lèvre d’enfant, son oxygène a animé mon corps, ses eaux l’ont abreuvé et creusé le lit de mes rivières, sa terre a finalement avalé ma mère. Tous les passés de cette terre s’entremêlent aux miens dans l’ordre et dans le désordre. Plus les images s’évanouissent, lentement, plus la séquence des choses s’entremêle, devient futile, l’importance de la vérité pure part en faiblesse, seule sa trace dans mon sang perdure vraiment, sinon les émois occasionnels qui m’assaillent, ceux-là même que je laisse parler les premiers. Mon passé enchevêtré parmi celui de toutes ces gens qui n’ont plus de nom ailleurs que dans le granit de leur épitaphe, appartient maintenant à celui qui veut bien l’écrire, celui qui croyait bien être là et qui tient encore le crayon dans ses mains. Tous ces passés m’appartiennent comme le mien appartient à tout un chacun, toutes ces histoires arrangées, brodées dans la trame du temps.
…
Parti de Rivière-du-Loup, Paul-Eugène Carrier était arrivé avec cinq de ses frères à Senneterre par le train Transcontinental en 1925 pour s’établir sur une terre que la couronne donnait aux colons prêts à s’engager à la défricher. Senneterre était jusque là essentiellement un poste de traite sur les grèves de la rivière Nottaway, aujourd’hui connue comme la rivière Bell. Vers 1914 affluèrent aussi quelques objecteurs de conscience qui fuyaient la conscription de la guerre 14-18, des rêveurs ou des pissous de chez nous ou de jeunes américains en exil qui étaient venus s’installer squattant les plus beaux spots sur le bord de la rivière, là où débarquaient les indiens, les canots pleins à ras bord de belles fourrures à commercer. Puis, le gouvernement du Québec prit l’initiative de peupler toute l’Abitibi avec un véritable programme de colonisation. C’est d’abord par la voie de l’agriculture que l’état prévoyait coloniser la région, autant réinventer l’enfer.
Le pays était entre deux guerres et les colons-volontaires s’y voyaient offrir gratis une terre bien à eux, se faisaient miroiter l’exemption de traverser de l’autre bord si jamais la guerre reprenait. L’hiver était ici sans merci, l’été trop court les mouches sanguinaires exaspéraient les colons. Les loutres et les renards morts de rire faisaient bombance dans leurs basses-cours, les pauvres terres de roche leur donnaient finalement bien peu à manger. Mais la misère était grande dans toute la province et l’appel de l’aventure se faisait racoleuse pour les jeunes hommes forts et en santé comme Paul-Eugène Carrier. Après 3 ans à s’étriper à l’ouvrage qui avaient valu à Paul-Eugène et à ses frères rien de plus qu’une installation rudimentaire, une habitation misérable sur une terre chiche, le destin lui sourit quelque peu du coin de la gueule. Il fut présenté à Adéline Gagnon, l’aînée d’une famille venue de la Beauce qui avait plus de filles à nourrir que la terre ne pouvait fournir de patates. Adéline, avec la beauté de ses 16 ans comme seule dot, était de plus de 10 ans la cadette de Paul-Eugène. Les fréquentations furent très brèves, le temps que lui et ses frères leur construisent un campe bien à eux et leur union fut bénie au printemps de 1929.
Puis, les saisons se sont mises à ramener les mêmes souffrances les unes à la suite des autres, rappelaient au secours du fond d’eux-mêmes les mêmes forces, les mêmes courages. La vie comme un long chapelet de miserere. Paul-Eugène n’était plus qu’une machine désabusée à bûcher l’hiver, à draver le printemps, à dessoucher l’été derrière un vieux boeuf fatigué que les frères se prêtaient tour à tour, tous les temps morts de l’automne à boire la bibinne de bouleau, à écouter les longs silences qui meublaient le campe. Adéline Gagnon qui n’avait pas su lui donner ne serait-ce qu’un fils qui aurait pu venir lui prêter assistance dans cette oeuvre de colonisation insensée et surhumaine, partie se réfugier depuis dans un profond silence, soumise, triste et honteuse, malheureuse . Qui prend mari…
En 38, Paul-Eugène et à peu près tous les colons de Senneterre en bonne santé répondirent à l’appel d’une compagnie de bois qui avait obtenu des permis en haut de la Nottaway. Six mois dans le bois, même pas le droit de revenir aux fêtes, mais il y avait de la belle argent au bout de l’hiver pour la famille qui mangeait alors de la grosse misère noire trois repas par jour. Adéline fût abandonnée seule dans son campe, ses plus proches belle-soeurs trois-quart de mille plus haut et trois-quart de mille plus bas. Grand bien lui fassent ses belles-soeurs, Adéline était pointée du doigt comme la femme incapable de mettre bas et de donner un fils à Paul-Eugène le frère de leurs propres époux. Déjà enterrée vivante dans un long malheur silencieux, Adéline ne sortait à peu près jamais du campe. Un petit mot échappé ici, une petite opinion là, un petit brin de malice par-dessus tout ça et voilà qu’une rumeur de folie s’allumait lentement autour d’Adéline. Et la rumeur brûlait déjà les langues sales jusqu’aux squats au bord de l’eau.
Un soir que la lune d’automne et la bibinne s’étaient mises en tête d’inspirer des mauvais coups aux plus vicieux, deux draft dodgers américains, des squatters de la Nottaway, ont pris le chemin du haut de la côte vers les terres des colons et sont venus payer une visite discrète à la belle Adéline. La pauvre fille n’avait même pas eu la force de se débattre. Leur cruel méfait accompli, les deux pissous assommèrent d’un seul coup de poing la pauvre Adéline gisant nue au sol et mirent le feu au campe avant de déguerpir comme deux rats galeux. Dans leur empressement coupable, le talent leur avait manqué. Le campe n’avait que boucanné par en-dedans des heures durant avant que les belles-soeurs accourent au petit matin et sortent Adéline inconsciente de là.
Ils la retrouvèrent telle que telle, nue, face contre terre, un mince filet d’air pur à ras le sol était venu épargner sa triste vie. Le visage tuméfié, quelques boursouflures éparses luisaient bien roses là où des tisons s’étaient posés sur son corps autrement noir de suie à la grandeur.
…
Il existe des noirceurs opaques au fond desquelles la mémoire cache bien adroitement les souffrances que nul ne saurait endurer, des choses que l’on décide d’oublier, qu’on renie de but en blanc. Quelquefois le temps d’en guérir, quelquefois pour toujours. Comme une commode noirceur qui recouvre les images qu’on ne saurait voir ni regarder, noirceur salvatrice. D’autres fois, pénombre ennemie, elle se place au contraire entre nos yeux et nos désirs de se rappeler. Nous bloque la vue totalement. Il fut pour moi au moins une année comme celles-là, une première, presque complètement noire, trop petit encore pour me défendre, pour y voir clair. Dernier enfant dans une grande maison vide, silencieux, deux saisons au moins, presqu’une pleine année seul… avec ma mère. Et il y a encore comme une couche de suie qui repose sur ma mémoire de ces temps-là, ne m’en révèle que de noires et fuyantes silhouettes, comme un théâtre d’ombres, des images évanescentes, ou peut-être ne suis-je que trop exigeant avec ce qu’un enfant de cet âge-là peut se remémorer. Des souvenirs de solitude comme si personne d’autre n’était là, ailleurs que simplement tous partis pour l’école, pendant de longs moments, comme si je n’étais pas là moi-même, désincarné, flottant mollement au-dessus de la scène. Pourtant, j’y étais, et elle aussi. Le souvenir de souffrances sorties de nulle part qui lui prenaient sans avertir. Je rage contre son silence, en silence. Je devais, je pensais y être pour quelque chose. Un seul mot innocent, un simple jeu d’enfant appelait-il sournoisement un mal si terrible qui s’emparait d’elle illico? Et ces jours-là, je crois bien que je jouais dans son secret avec elle, je croyais que je la libérais, je fuyais chez des madames le temps que le temps passe et avec lui la douleur. Puis je rentrais m’appuyer un moment sur sa cuisse chaude, m’accrocher en silence à son bienvaillant sourire revenu.
…
Nous n’avions rien fait pour mal faire mais les enfants sont tellement innocents quelquefois. Dès que la porte s’était refermée derrière notre mère, notre génie n’a pas mis bien longtemps à comprendre que nous avions maintenant les coudées franches, toute la maison sous notre seul contrôle, terrain de jeu nouveau aux possibilités immenses sans supervision aucune. En 62, la télévision ne diffusait à peu près rien pour les enfants dans la journée. Quelques niaiseries en anglais le matin, le Friendly Giant ou chez Hélène qui s’adressait aux enfants indistinctement en anglais ou en français sur un ton tellement condescendant, comme si les enfants étaient des êtres nuls et insignifiants. Puis vers 4 heures, la Boîte à surprises et Bobino en français seulement. Mais dans le jour, rien. Les enfants de mon époque jouaient davantage dehors que dans les maisons. Mon frère et moi y étions séquestrés en quelque sorte, forcés de se trouver une occupation en attendant que notre mère revienne de faire sa liste électorale. Et toutes ces petites promesses du bout de la gueule semblaient bien loin derrière, nos mémoires ont eu comme une petite faiblesse et nos deux génies ont décidé simultanément de prendre congé.
Nous étions cependant inspirés d’une bonne intention. Descendus directement dans la cave, au fin fond de la chambre à fournaise, nous nous étions mis à deux pour transporter la grosse balayeuse Hoover jusqu’en haut, faire plaisir à maman, passer une belle balayeuse en haut. Tout serait propre et Spic’n Span à son retour. Nous n’avions aucunement le droit d’opérer cette machine d’enfer mais elle serait si contente, nous disions-nous, de retrouver la maison toute propre et sans minous qui roulent partout, le crime serait vite pardonné.
La machine était tellement lourde, toute une saga dans l’escalier de cave, heureusement que mon frère Marc était plutôt costaud pour un bambin de 6 ans. M’étant installé sur le haut des marches, j’avais agrippé l’engin par le manche et je tenais le long fil pour ne pas qu’on s’enfarge dedans. En fait, je ne faisais que conserver la chose en équilibre. Mon frère Marc le pied de l’engin bien en main, par là où se trouvait la partie la plus lourde, son moteur, fournissait la force nécessaire à faire s’élever la machine jusqu’au haut de l’escalier. Par coups successifs, une ou deux marches à la fois, la bête s’est retrouvée en haut bien malgré elle. Nous avons ensuite roulé la chose jusqu’au milieu de la cuisine et nous l’avons branché à la place du grille-pain. Marc, qui avait fourni le gros de l’effort, revendiquait le privilège de pousser sur le petit interrupteur en forme de bâtonnet et d’inaugurer le bal. Je me tenais prudemment derrière. Lorsque le vrombissement s’est fait entendre. Peut-être avions-nous un peu trop brassé la machine dans l’escalier, assurément que l’oncle Michel n’avait pas vidé la grosse poche de suie attachée au manche de la balayeuse, toujours est-il qu’un nuage de fumée noire a aussitôt été expulsé du derrière de la Hoover.
Frérot, paniqué, s’est aussitôt mis à frapper frénétiquement à la recherche du petit interrupteur, au moins deux ou trois coups avant que le monstre ne se taise une fois pour toutes. Stoïques, sidérés, immobiles un long moment, nous ne laisserions tout de même pas la stupide machine dominer l’homme, les deux ti-culs que nous étions en fait. Nous la fixions en pleine face à la recherche d’une solution. Le nuage avait bien laissé un petit dépôt de suie se déposer calmement au parquet, il fallait que la balayeuse reparte, éxécute docilement son oeuvre de propreté. Notre projet en dépendait. Il fallait trouver le moyen de vider le sac et de redonner tous ses moyens à la machine.
Nous cherchions partout le bon piton, la petite clanche, le bidule quelconque pour détacher la grosse poche du manche de la machine pour pouvoir la vider quand je criai à mon frère, tout content: “Tiens, regarde, il y a un zip icitte.” tout en descendant ledit zip jusqu’en bas de la poche d’un grand coup sec.
Une rivière de suie noire a jailli de là, partie comme une débâcle. Comme si on avait défoncé une dam de suie, plein de petits roulis enfumés partaient, se dispersaient en roulant sur eux-mêmes, élargissaient, s’éparpillaient en s’éloignant jusqu’à la salle à dîner plus loin. Quand cette chorégraphie de l’enfer s’est arrêtée, nos neurones sont comme partis prendre l’air un bon moment avant de revenir tenter de nous inspirer une fin heureuse pour cette catastrophe innommable.
Notre premier réflexe, le balai de paille. Très mauvaise idée, la suie ne faisait que s’élever et fuir encore plus loin. La belle vadrouille verte de maman, guère mieux. À chaque tentative, nous nous noircissions nous-mêmes de plus en plus et la suie s’étendait. À la guerre comme à la guerre, nous avons rempli une grande chaudiérée d’eau et découragés de chercher une bonne moppe, nous avons utilisé d’abord tous les linges à vaisselle que nous avons pu trouver, puis une bonne quantité de serviettes. Nous avons commencé à réaliser que le drame était hors de contrôle juste à temps pour épargner les draps de lit qu’on avait tout de même sortis de la lingerie.
La crasse ne faisait que s’étendre, pénétrer partout, sa force polluante décuplée par l’eau. Pas question de ne battre qu’en retraite, nous avions épuisé toutes nos munitions, il ne nous restait plus que la fuite, définitive. Marc avait décidé de terminer ses jours, comme Anne Frank, terré dans un cagibi au deuxième étage sous les appentis fermés de la couverture avec tout le pot de biscuits-éponges aux confitures comme réserve. Moi j’ai carrément pris le maquis loin de la maison, fuyant à toutes jambes par le tambour sur le côté.
…
La chaleur du feu m’est venue du passé par la mémoire du sang, elle poursuivait le camion où étaient blottis à travers d’autres familles, mon oncle Jos, ma tante Odile et leurs plus vieilles Lucille et Jacqueline, partis avec rien d’autre que le linge qu’ils avaient sur le dos, abandonnant tout le reste derrière. Là où les maisons ne brûlaient pas déjà, on installait les enfants sur les toits et on leur demandait de prier les bras en croix, les visages tournés vers un ciel rouge-orangé par le feu qui emportait déjà tout le haut du village de Pascalis. Le bon dieu est apparemment plus sensible aux prières des enfants. Miserere, seigneur. Tous les hommes, tous les mineurs étaient réquisitionnés pour combattre le brasier. La fuite s’organisait du même coup. Dans les boîtes de camion de la mine Beaufor, de la Cournor et de la Perron-Pascalis s’empilaient les femmes et les enfants qu’on allait porter plus loin.
Adéline Gagnon hurlait le nom du petit resté pris au deuxième étage dans leur petit logement. “Marcel! Marcel! Viens-t-en Marcel, descends de d’là!”, criait-elle en se débattant comme un diable dans l’eau bénite. Et les voisines retenaient la pauvre femme de peine et de misère de peur qu’elle ne s’élance dans le brasier. “Paul-Eugène, viens m’aider, va me chercher Marcel en haut.” Mais Paul-Eugène était loin, beaucoup trop loin.
En 1939, de retour du chantier, Paul-Eugène Carrier avait retrouvé son campe dévasté, Adéline hébergée par sa belle-soeur Germaine, méconnaissable, renfermée sur elle-même comme une huître, silencieuse, le regard vide. Et partie pour la famille, un petit bedon bien rond témoin de la chose. Incapable de faire face aux dires et aux calomnies qui circulaient, découragé d’avoir à tout recommencer, tout reconstruire, les sentiments mêlés par rapport au bébé porté par sa femme, son futur statut de père de famille tant espéré, Paul-Eugène décida de partir de Senneterre dans l’espoir de redonner vie à sa belle Adéline.
L’année précédente, le gouvernement du Québec avait subdivisé des lots dans le canton de Pascalis afin de construire un véritable village minier pour les travailleurs des mines et de leurs familles. À peine à 800 mètres de Perron, alors village improvisé de squatters que les autorités ont bien tenté d’inclure au projet, même envisagé de nommer la nouvelle ville Perron, mais les squatters ont résisté. La ville fût donc officialisée en 1939 sous le nom de Pascalis. La ville s’organise rapidement dans l’idée d’en faire une ville moderne, poussant jusqu’à la prétention de devenir la capitale de l’Abitibi, de devenir plus grosse que Val d’Or ou Amos. La localité était située le long d’un vaste triangle, à l’intersection des routes reliant le futur village de Pascalis à Obaska, à l’est, et à Val-d’Or, au sud. La construction, amorcée en 1938, va bon train. La rue principale compte très rapidement un bureau d’avocats, des hôtels, une boulangerie, une station-service, des restaurants, des magasins, même une salle de cinéma moderne. En 1939, Pascalis était électrifiée. Paul-Eugène Carrier sans véritable métier devint surveillant de mine pour la mine Cournor, une belle job steady qui lui permettait de faire vivre Adéline et le petit.
À l’été 1944 un brasier enflamma toute la ville de Pascalis qui fût réduite en cendres et jamais reconstruite depuis, ses habitants dispersés entre les autres villes minières de Lamaque, Malartic, Sullivan et Val d’Or.
La paix n’était jamais vraiment revenue pour la belle Adéline, sa vie était comme suspendue dans le temps. Hier, demain, tantôt, il y a dix ans ou l’année suivante, du pareil au même. Il n’y avait plus que le petit Marcel, il atteignait ses cinq ans et n’avait ni frère ni soeur encore quand Pascalis s’est enflammée. Et après un temps, Paul-Eugène s’était docilement plié aux mesquins calculs de ses belles-soeurs. Quand le petit Marcel est né en juillet 1939, à terme et bien en santé, elles avaient compté et recompté. On comptait très juste dans ces circonstances-là.
Elle n’espérait plus que Paul-Eugène revienne et monte chercher le petit, elle savait bien qu’il savait, que le petit paierait pour la méchanceté de deux salauds de draft dodgers des états, pour une nuit noire qui avait emporté son essence dans les abysses de la tristesse, pour la force qu’elle n’avait pas eue de s’en défendre, pour la peine immense de Paul-Eugène. Et elle s’immobilisa net dans les bras de ses voisines, son esprit enfui pour de bon, une fois pour toutes, résignée, tombée dans une immense craque ouverte dans l’espace-temps, les yeux vides comme un trou sans fond.
Paul-Eugène l’installa dans une petite maison de Lamaque où on avait aménagé à sa demande une chambrette pour le petit Marcel, déposé les petits jouets de métal qu’elle avait supplié Paul-Eugène d’aller ramasser dans les cendres. Un petit tracteur de ferme, un petit camion avec une boîte, une Ford modèle T en tôle, un camion de pompier qu’elle avait tous patiemment nettoyés, repeints. De beaux petits vêtements de garçon pleins la petite commode, des petits souliers. Une grosse barrure sur la porte de la petite chambre pour que jamais, personne n’aille là-dedans.
Mais contre toute attente le petit Marcel, de la brume des ans s’est mis à resourdre, par lui-même, comme il était disparu. Paul-Eugène était parti travailler à la mine Lamaque. Elle était seule. Elle l’a vu apparaître, l’a vu venir de l’autre bord de la rue, une belle journée d’été qu’elle travaillait à quatre pattes dans ses fleurs. Une paix immense est descendue l’envelopper toute entière, une horloge s’est rallumée sonner l’angélus juste pour elle, elle s’est levée et s’est avancée bien calmement et est venue à ses devants. Marcel était encore essoufflé, on sentait qu’il avait consenti de gros efforts dans sa fuite, il était encore noir de suie mais heureusement il avait échappé aux atroces brûlures. Elle l’a pris tendrement contre elle un long moment en silence, lui a tendu la main et l’a emmené dans la maison. Elle fit couler un bain pour lui, le déshabilla et le décrotta patiemment de la tête aux pieds, l’assécha, le brossa. Elle sortit la clé bien cachée et elle débarra le gros cadenas, ouvrit la porte de la chambre de Marcel, choisit de beaux vêtements propres pour lui et le rhabilla. Elle l’installa sur le beau tapis tressé qui décorait le pied du lit et lui descendit des étagères les petites voitures de métal et le beau petit camion de pompier qui l’amusait tant. Elle s’installa dans la berceuse et le regarda s’amuser calmement une bonne partie de l’après-midi avant de s’endormir doucement un beau sourire sur son visage. Quand Paul-Eugène est rentré, Adéline Gagnon s’est réveillée avec le plus beau sourire encore suspendu dans l’éternité. Le petit était reparti, volatilisé, aspiré tout entier dans le beau sourire d’Adéline pour toujours.
…
Les témoins du temps révolu n’ont plus de main à lever pour jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et puis? À chacun sa chacune, toutes s’entremêlent, prennent une saveur unique ou des millions d’arômes différents, les vérités s’acoquinent les unes aux autres ou se livrent une guerre sans maître, tout un chacun a bien droit à la sienne.
Le squelette d’une salle de projection en béton, l’épitaphe d’un pan d’histoire, debout en pleine forêt au bout d’un vieux chemin de gravelle envahi par les hautes herbes, intrigue pour les randonneurs des siècles à venir, témoignant à lui seul d’un énorme rêve parti en fumée. Un vieux film qui comptait bien quinze, seize-cent acteurs, là en 1944. Et tout cela est pourtant bien vrai, la désillusion des âmes errantes se mêle à la phéromone des bois alentour, on la sent encore. La ruine d’une salle de projection projette encore un tribizillion d’odeurs de tristesses, le parfum de ma tante Odile perceptible à travers elles. Tous ceux que le gouffre du temps a absorbés sont désormais du même pays, de la même mémoire, parlent la même langue entre eux. Aucune vérité ancienne n’a besoin de témoins de béton qui jurent solennellement, pour avoir été, pour être racontée. Rien qu’une plume suffit, un crayon.
Ma mère n’aura jamais goûté les belles fesses de porc que je mets occasionnellement sur la broche pour mes frères ses fils, pour toute sa petite descendance qui court partout. Elle n’aura jamais vu ma maison dans le bois, mes fils qui lui ressemblent tant, leurs petits qui n’auront d’elle que les mots qu’on leur racontera, de vieilles photographies sépia qu’on leur montrera, elle n’aura jamais flâné avec ma douce dans sa balançoire les beaux soirs d’été à endormir un petit, en chantant Froufrou ou quelqu’autre vieille chanson, en sirotant un p’tit rouge ou un bon café chaud. Plus jamais sur moi son sourire bienvaillant ne se déposera, plus jamais sur sa cuisse chaude ma joue qui la cherche encore ne retrouvera le réconfort. Cela fait énormément de regrets pour un seul homme, pour une seule vie. Mais qui dit qu’elle ne sera pas là, la prochaine fois, dans un passé qui s’en vient, dans une histoire vraie qui reste à inventer, ça se peut, tout se peut. Son sourire reviendrait de l’éternité, elle humerait le bon cochon qui tourne sur la broche, elle serait là à servir le monde, ou elle courrait dans le bois avec les petits ou elle m’aiderait en placotant à faire la vaisselle après souper.
Parce qu’en réalité, comme le disait Régis Franc, tout ça se passe dans la tête.
…
Ma mère un peu sous le choc, découragée et hébétée par l’état des lieux avait appelé sa soeur Colombe au secours. À deux elles avaient tout décrotté et remis la maison en bonne condition en quelques heures, toute trace de suie disparue. Les recherches pour retrouver mon frère Marc n’avaient pas été des plus ardues. En suivant les pistes noires laissées derrière, elles avaient été guidées directement au repère d’Anne Frank qui mangeait tranquillement ses biscuits-éponges aux confitures dans la noirceur du cagibi. Trop sale pour le bain, il avait eu droit à un frottage en règle, paroisse par paroisse, debout dans le grand lavabo de la cave et était maintenant assis sagement, bien propre, devant le Pirate Maboule.
Mon absence lui pesait et tante Colombe avait bien rassuré ma mère à propos de ma fugue. “Comme je le connais, il doit encore être parti chez une de ses madames, tu le connais bien assez toi aussi, il va revenir pour souper, inquiète-toi pas de même, zouzou.”
Bien des choses me terrorisaient encore à ce moment-là mais je devais effectivement penser à rentrer à la maison un jour ou l’autre. On craint toujours les pires représailles dans ces moments-là, l’ignorance de ce qui se passe véritablement à la maison, la réaction de ma mère.
Mais je retrouvais encore et encore son sourire bienvaillant, la vengeance ne faisait pas partie de ses manières, elle était une mère aimante, jalouse de ses petits. Elle était assise bien tranquille à la table de la salle à dîner avec sa soeur, ma tante Colombe, chacune avec une tasse de café, jacassant, fumant nonchalamment des cigarettes, déjà passées à autre chose. Des images qui collent au coeur pour toujours. Les deux soeurs ont bien ri quand elles m’ont vu entrer.
“Viens ici, mon petit juif.” me lança ma mère tout de go. Je me suis rapproché d’elle, nerveusement quand même. Elle me prit par le cou et m’approcha tout près d’elle. Elle m’examina le fond de la tête en tâtant délicatement du bout des doigts comme si elle cherchait des poux, même chose avec les oreilles. En réalité elle cherchait des traces noires de suie, en vain. Puis elle se donna du recul en me repoussant tranquillement les deux épaules au bout de ses bras et elle m’examina longuement de la tête aux pieds. “Veux-tu bien me dire c’est qui qui t’a lavé pis où t’as pris ça ce drôle de linge-là?” questionna-t-elle en passant très délicatement ses mains toutes chaudes et douces sur mes deux joues. “T’étais passé où toé cou’don?”
“Chez mon amie Adéline Gagnon, je jouais dans ses secrets avec elle.”
Flying Bum.


Aujourd’hui, la forêt a repris ses droit à la grandeur de ce paysage d’autrefois. Du cinéma Pascalis, de Charles-A. Magnan, il ne reste plus que la cabine de projection bétonnée, étrange habitant d’une forêt de trembles. L’édifice, initialement recouvert d’un beau stuc bleu, avait pourtant la réputation d’être à l’épreuve du feu. Ces ruines sont restées à peu près intactes, et sur le sol cimenté de l’immeuble on peut encore aujourd’hui retrouver des ressorts qui assuraient le confort des sièges rembourrés du cinéma. – Collection : R. Robillard, Source : Denys Chabot, Jean L’Houmeau, Jean Robitaille. « Le feu de Pascalis » dans Perron Pascalis. Val d’Or, SHVO, 1996, p. 41-49.
Quelques belles photos plus récentes prises par M. Éric Foucart publiées sur le groupe Facebook Nous, les Abitibiens.



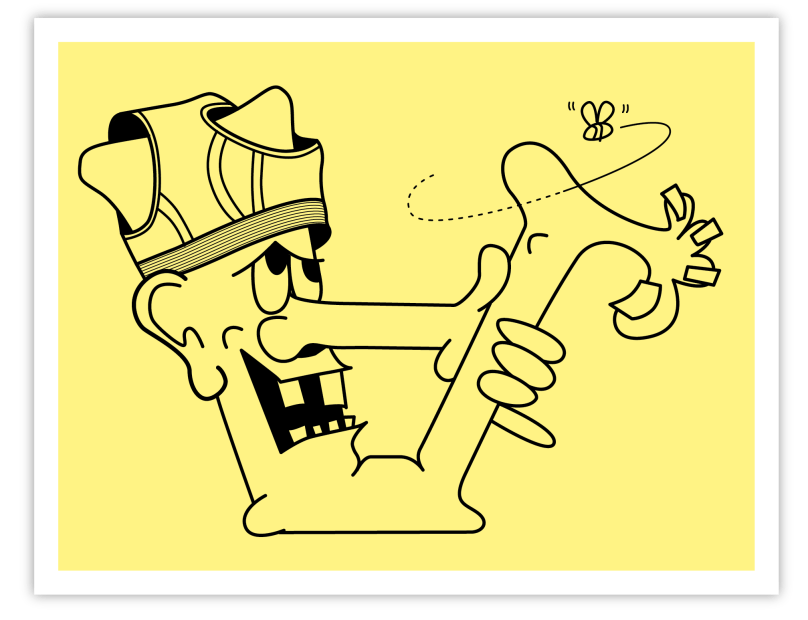















 personnes qui passent une mauvaise nuit, ils sont terrés sous le lit prêts à bondir, se prêter aux pires violences, se livrer sur nous à toutes les bassesses, suffit de laisser pendre un pied hors du lit. Ils se tapissent souvent dans l’ombre mais plusieurs opèrent au grand jour, d’autres bonhommes ne sortent jamais avant sept heures. Les miens se tenaient dans un cagibi au bout du toit pentu du deuxième étage où se situait ma chambre, derrière un petit muret qu’on y avait construit. Ceux de mon fils Julien se cachaient dans le regard vide des automates pourtant conçus pour faire rire les enfants. Celui de mon fils Emmanuel prenait vie nuitamment au fond d’un garde-robe sous la forme d’un chauffe-eau, et curieusement le monstre prenait le logo collé sur le réservoir comme visage pour venir le faire suer de terreur. Il ne suffisait que de fermer la porte pour dompter la bête, jusqu’au lendemain soir.
personnes qui passent une mauvaise nuit, ils sont terrés sous le lit prêts à bondir, se prêter aux pires violences, se livrer sur nous à toutes les bassesses, suffit de laisser pendre un pied hors du lit. Ils se tapissent souvent dans l’ombre mais plusieurs opèrent au grand jour, d’autres bonhommes ne sortent jamais avant sept heures. Les miens se tenaient dans un cagibi au bout du toit pentu du deuxième étage où se situait ma chambre, derrière un petit muret qu’on y avait construit. Ceux de mon fils Julien se cachaient dans le regard vide des automates pourtant conçus pour faire rire les enfants. Celui de mon fils Emmanuel prenait vie nuitamment au fond d’un garde-robe sous la forme d’un chauffe-eau, et curieusement le monstre prenait le logo collé sur le réservoir comme visage pour venir le faire suer de terreur. Il ne suffisait que de fermer la porte pour dompter la bête, jusqu’au lendemain soir.










