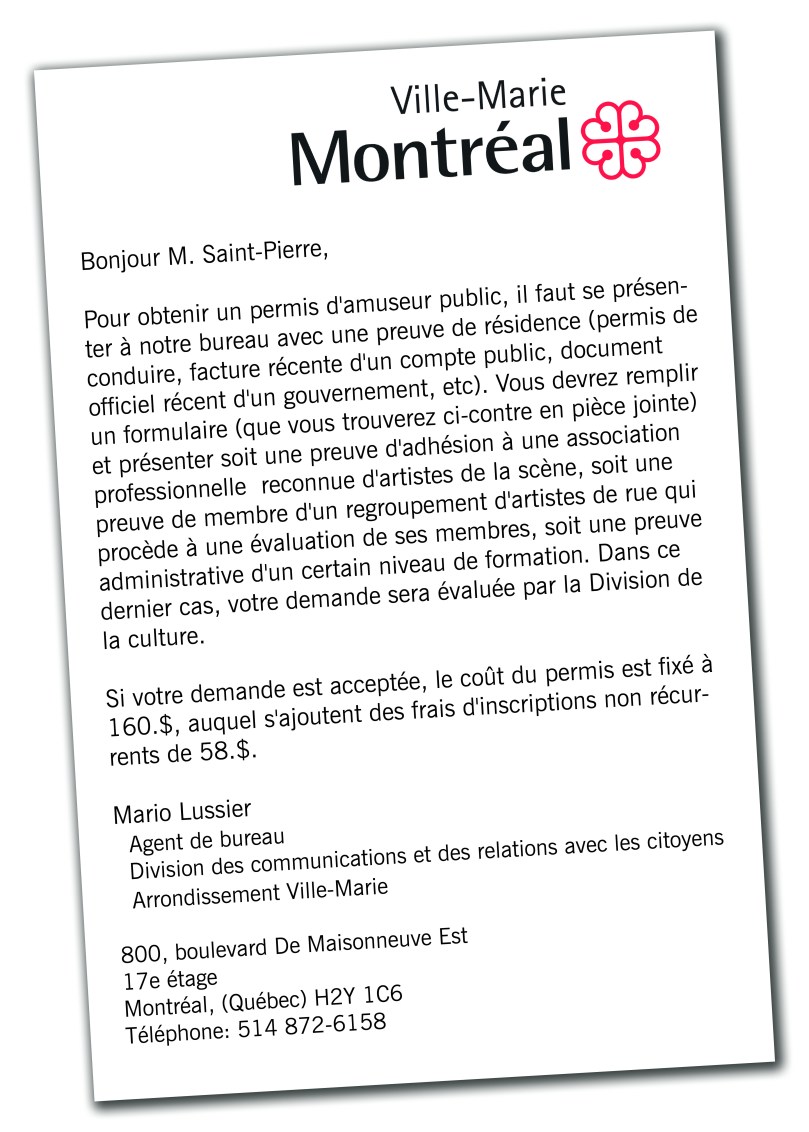Le vent du nord soufflait franc-sud rue de Gaspé, déserte à cette heure, nuit sans lune sur Montréal qui luisait sous un glacis de vieille pluie froide pas encore séchée. Des nuées de feuilles se soulevaient comme des volées d’étourneaux et tourbillonnaient un moment dans les airs avant de finir leur danse au sol dans une chorégraphie en rase-mottes zigzagants. Ou collaient sur les pare-brises suintant.
Rideau inespéré offrant une meilleure chance de ne jamais être vu à l’homme assis calmement derrière son volant. Le vieil homme avait patiemment attendu la tombée de la nuit dans sa bagnole stationnée illégalement dans une zone réservée aux résidents. Il n’avait évidemment pas la vignette. Il avait longuement écouté une ligne ouverte bien connue histoire de passer le temps et de voir venir la noirceur, félicitations pour votre beau programme et bien le bonsoir, on vous aime beaucoup à la maison. L’animateur répétait sans fin, monocorde: “Madame, madame, madame, madame, . . .” à une auditrice frustrée de voir son joueur préféré parti poursuivre sa carrière à Boston ville-ennemie maudite.
Il craignait moins de voir apparaître un préposé aux contraventions que le propriétaire de la maison devant laquelle il était illégalement installé. L’autre n’avait jamais possédé la moindre automobile de sa vie. Ou la police. La police verrait peut-être la boîte, la fouillerait qui sait? Poserait des questions. Il était venu en éclaireur quelques jours auparavant s’assurer que l’autre habitait encore là. Bien des années s’étaient écoulées tout de même. Et à l’heure où les ronds-de-cuir rentrent à la maison, il l’avait bel et bien vu, reconnu. Son coeur a pincé sec un moment. L’autre vivait toujours là, seul avec ses bibittes, marchait en se marmonnant des choses à lui-même la tête basse, sa ridicule sacoche de gars sous le bras. Il était bien à la bonne place, seulement il était vingt ans plus tard, vingt ans plus vieux. Mais tout semblait être exactement comme si on y était encore, ce soir de triste mémoire, maudit entre tous, revenu pour enfin en écrire l’épilogue.
Tellement de temps était passé par là depuis, souvent sur les paumes endolories, les coudes râpés, sur des fesses échauffées, le temps de tout oublier. Le temps d’y repenser, de ronger son frein, puis d’oublier à nouveau, de dire merde, que le diable l’emporte, qu’il crève. Le temps de souffrir encore un peu. La douleur avait été trop vive, la lame était pénétrée trop profondément dans ses chairs pour espérer une guérison rapide, pour espérer toute forme de guérison finalement. Puis la pensée obsédante revenait, insistait. Il fallait faire quelque chose récitaient des petites voix. Vingt ans, c’est long. Le jour “J” était venu enfin, déguisé en soir d’automne venteux. La vengeance était hors de question mais un peu de drame aura toujours sa place pensait-il. Il y avait tellement longtemps qu’il en rajoutait dans sa grosse boîte de chocolat Black Magic en métal noir qu’elle était maintenant probablement devenue une pièce de collection. Une éternité que ça ne se voyait plus des chocolats en boîte de cinq livres. La marque existait-elle encore seulement? Tellement longtemps qu’il ne comptait plus la somme lentement accumulée dans la boîte. Il s’y trouvait assurément quelques billets verts d’un dollar ou des vieux deux piastres en papier brun. Toute la somme y était, le couvercle fermait à peine. Une bonne somme, quand même. Pas que des deux et des unes là-dedans, oh que non.
Une noirceur suffisante et fort assurément le goût d’en finir une fois pour toutes lui donnèrent le go. Il retira les clefs du volant, tout s’éteignit, sons et lumières. Il prit la boîte de Black Magic avec lui et quitta la voiture en fermant délicatement la portière pour ne rien ameuter. L’autre était propriétaire du bloc, gros triplex de brique typique du quartier Villeray, trois logis superposés sur autant d’étages, avec son grand escalier au garde-fou de fer forgé qui partait du trottoir et allait rejoindre le balcon du deuxième où de là une porte donnait accès au logis du deuxième, une autre au logis du troisième par un escalier intérieur. L’autre habitait le deuxième contrairement à tous les propriétaires qui occupaient généralement le rez-de-chaussée, à tout seigneur, tout honneur. Mais l’autre, lui, préférait de loin collecter le gros loyer qui vient avec les avantages d’habiter le premier plancher. Il habitait le deuxième qui rapportait généralement beaucoup moins. Que le troisième, même, où la vue imprenable sur le centre-ville venait en rajouter au loyer de base. L’autre, pourrait-on dire, avait peur d’en manquer un jour, de l’argent. Et pourtant. L’un aurait payé cher pour voir la gueule de l’autre plus tard, mais ce n’était pas là l’idée. S’imaginer les choses constituait davantage son pain et son beurre, les petits délices de son âme de rêveur. La réalité pouvait se faire si décevante parfois.
Ce n’était définitivement pas un bon soir pour grimper les marches deux par deux et risquer de réveiller le bloc ou de se briser un os dans l’escalier. Il monta les marches du bout de ses pompes comme si elles étaient de fines tablettes de cristal en s’agrippant systématiquement à la main courante. L’ascension semblait interminable, entrecoupée de forts coups de vent pendant lesquels il s’immobilisait complètement pour mettre sa main libre sur la boîte de chocolats Black Magic, en cas. Sur la dernière marche, il examina longuement l’état des planches du balcon, tentait de localiser du regard la boîte aux lettres. D’une part, le vertige l’accablait de plus en plus en vieillissant et même cet escalier plus qu’ordinaire avait fait grimper son rythme cardiaque et son coeur fit un tour supplémentaire quand il se rendit compte que le logis de l’autre n’avait pas de boîte aux lettres. Il vit, et se calma les émotions d’autant, le typique passe-lettres dans le bas de la porte, ouf. Il s’en approcha à quatre pattes pour ne pas projeter son ombrage devant la fenêtre derrière laquelle l’autre dormait probablement. Il déposa la boîte de Black Magic par terre devant lui sur la carpette de chanvre hérissé. Elle ne passait pas dans la fente, c’était d’une évidence. Il ouvrit le couvercle de la boîte à pentures en s’assurant de le placer entre le vent du nord et les billets. À la première tentative, une bourrasque bien placée le fit paniquer et il referma le couvercle prestement. Puis s’y remit une fois pour toutes. Une petite pile à la fois, il tenait d’une main la porte à bascule du passe-lettres puis poussait les billets pour s’assurer qu’ils étaient tous passés et il observait la pluie de billets se déposer éparse sur le sol du vestibule. Puis une autre petite liasse, puis une autre petite liasse. Le vent faillit en emporter une, un ou deux billets s’envolèrent. Au diable, pensa-t-il, ça lui fera ça de moins, c’est tout. Et une autre petite liasse, et une autre petite liasse. Il voyait le fond de la boîte maintenant. Il serait bientôt sauf, délivré, et rigolait en-dedans de lui à l’idée que l’autre aurait pu appeler la police pour se plaindre de s’être fait nuitamment introduire plein d’argent par la craque de la porte.
Une sensation étrange l’envahit tout de même, vive et soudaine. Normal, l’ordinaire prend le bord d’un point de vue des sensations lorsqu’on atteint cette sorte de borne inévitable plantée depuis longtemps sur l’accotement de notre destinée, un rideau enfin levé puis retombé sur des scénarios si inlassablement répétés. Mais c’était tout autre chose. Il leva légèrement les yeux et vit une masse nouvelle dans le vestibule. Une chaleur intense lui partit du cou, descendit tout le long de sa colonne puis remonta prestement à son cerveau sonner l’alarme, semer la terreur, carrément. Une forme noire immobile et incommodante se trouvait dans le vestibule derrière le rideau de la porte, grande silhouette d’homme. Avant qu’il n’ait eu le temps de déplier ses vieux genoux et de se remettre debout en appuyant ses mains sur la porte, la lumière jaillit de partout en même temps que la porte s’ouvrait d’une claque devant lui. Il perdit appui et s’écrasa lamentablement, le visage dans la petite montagne de billets, aux pieds de l’autre bien debout les orteils dans le fric éparpillé.
…
La ville avait aménagé ce petit parc suivant le modèle des squares européens d’une autre époque. On l’avait d’ailleurs baptisé du nom d’un obscur poète florentin pour flatter les italiens qui avaient jadis peuplé ce quartier en grand nombre. Un bâtiment d’à peine cent pieds carrés, une vespasienne condamnée depuis belle lurette qui offrait dans le coin du parc un refuge contre le vent. Ça et l’épais buisson de chèvrefeuille qui délimitait le fond de ce coin de verdure dans la ville grise formaient une petite enclave de paix à l’abri des soucis. L’itinérante était installée là, assise au pied du mur. Plusieurs des sacs qu’elle transportait partout avec elle avaient été mis à l’abri sous la haie, les plus précieux restés près d’elle. Les yeux dans le vide, elle se payait un cinéma imaginaire lorsque d’aventure un essaim de feuilles mues par le vent venaient lui offrir un grand ballet juste pour elle. Elle leur marmonnait l’accompagnement tout bas. Sur un fond de ciel bleu-mauve, les danseuses écarlates, orangées, jaunes, allumées par le lanterneau de la vespasienne, peignaient devant ses yeux des Riopelle dansants avant de venir se déposer à ses pieds. Puis d’autres revenaient en rafales et dansaient encore pour elle. Entre deux actes, au sol à travers les danseuses aux couleurs de feu gisant épuisées, deux taches violettes avaient atterri doucement devant la vieille dame soudain ébaubie. Venus d’on ne sait où, deux beaux billets de dix piastres avec la reine dessus.
…
“Olivette, ciboire, qu’est-ce que tu viens faire dans mon histoire? Je t’avais bien averti, on ne retouche plus jamais à ce sac-là. Jamais. Pas celui-là. Remballe-moi tout ça, fais trois-quatre noeuds avec les poignées et enterre-le en dessous de la pile. Il y a de très grosses blessures dans le fond de ce sac-là, laisse ça là. À part ça, depuis quand tu as le droit de t’inventer des rôles? Dois-je te rappeler que tu ne vis que dans mes songes tordus? Une bouteille de rouge et tu n’existes même plus.” J’étais hors de moi.
“Bon, des menaces!” répliqua Olivette. Olivette est une bag lady, clocharde céleste et mal engueulée qui en mène large et qui squatte depuis des lunes la tête de l’autre et qui se charge d’ensacher ses mémoires soufrantes par petits tas bien classés.
“Tu sais comment j’aime le chocolat, je n’ai pas pu résister quand j’ai vu la boîte. Cinq livres de chocolat, y as-tu pensé? Ensuite, je l’ai ouvert et j’ai commencé à réaliser ce qu’il y avait dedans vraiment, on est loin du chocolat. Et ça n’avait pas l’air de ton histoire pantoute, rien de personnel en tous cas. D’abord, les bouts sont tout mélangés mais ça, c’est bien toi, on te reconnaît. Mais lui, le “il”, le vieux, l’un et l’autre, qui est qui là-dedans?, c’est personne tout ce monde-là en fin de compte, non?” questionnait la clocharde confuse, avec insistance.
…
Il ne s’était jamais vraiment arrêté rue de Gaspé avant. Dans ce coin-là, les frênes matures formaient une voûte impressionnante au-dessus de la rue. L’automne devait y être magique. L’autre y avait acheté un triplex plus tôt cet été-là après avoir été locataire une bonne partie de sa vie, depuis qu’il avait enterré son père, il y avait de cela une bonne vingtaine d’années. Lui s’était stationné de l’autre côté de la rue selon ce qu’il avait compris des affichettes de stationnement kafkaïennes typiques de Montréal.
L’un et l’autre s’étaient connus un peu sur le tard. À l’âge où on commence à peine à devenir des hommes. À l’âge où l’innocence se meurt déjà sous le poids de bien des choses déjà inventoriées dans la liste des pas jo-jo. Et lourdes quelquefois même. Quasi impossibles à réparer déjà. Ils partageaient beaucoup de ces coups de Jarnac du destin. Mais de toutes ces choses que la vie plaçait devant ou laissait derrière eux, ils ne s’en parlaient jamais vraiment. Ni l’un ni l’autre. Muets. Tout cela se passait dans le non-dit d’une amitié profonde. Ils avaient tout deux goûté un peu du même crottin collé dans le fond du poêlon de la vie. Ils avaient ce genre de conversations sans mots où tout s’entend. Ça leur donnait aussi une fâcheuse tendance à vouloir endormir le mal de temps en temps, faire sortir le méchant. Quand les jeunes coqs en goguette s’endormaient dans leurs ronds de bave d’avoir trop fêté et que l’autre les réveillait pour les mettre dehors, que les gars de banlieue couraient après les taxis désespérément sur Pie-IX, frustrés d’avoir manqué le dernier bus, il ne restait souvent que l’un et l’autre pour refaire le monde de but en blanc ou plus bêtement finir les bouteilles abandonnées là par tout un chacun. Et là, ils pouvaient dépasser tranquillement les bornes, s’imbiber, s’enfumer, quelquefois jusqu’au délire. L’autre partait ensuite se coucher et l’abandonnait à un vieux divan dans un recoin de la cave, asile pour les âmes en peine. Tout cela semblait si loin derrière maintenant. Un jour, il a bien fallu devenir des hommes. S’assagir un peu. Et le temps disperse toujours un peu les hommes aux quatre vents. Mais chacun d’eux savait toujours à peu près où se trouvait l’autre.
Il était comme paralysé dans sa voiture et n’osait pas en sortir. Un noeud lui serrait la gorge, son torse endurait une pression insoutenable, l’angoisse était en train d’avoir sa peau. Et la honte. Une honte sans nom, de celles qui se nourrissent de l’indigence, des pétrins sans fond dans lesquels on pouvait se plonger soi-même à force de négligence, de faiblesse. La gêne que seul l’argent a le pouvoir d’engendrer. La honte qui tue. L’autre n’aurait jamais pu s’enliser dans cette vase-là. Il avait depuis longtemps compris que l’argent était le nerf de la guerre, il avait vu son père vivoter sur des salaires de misère, s’était juré qu’on ne l’y prendrait jamais. On ne le surprendrait jamais, oh grand jamais les goussets vides. Lui, il aurait voulu se trouver n’importe où sur cette foutue planète plutôt que là, rue de Gaspé, à aller accomplir la seule démarche qui lui semblait maintenant possible de faire, s’humilier encore un peu plus.
Quand l’insignifiance des choses qui se racontaient à la radio de bord lui devint insupportable, il tourna la clef du volant et le supplice s’arrêta avec le ronronnement du moteur. C’est davantage un automate qui ouvrit la portière pour s’extirper de la Chevrolet. La chaleur humide de la canicule urbaine lui sauta à la gorge, contraste sauvage avec la cabine climatisée, et les genoux lui fléchirent. Le tunnel superbe manquait d’air, il étouffait. Il appuya ses deux mains sur le capot un moment pour reprendre ses esprits et laisser fuir les picots noirs.
Il reprenait encore lentement ses forces, retrouvait la vue et ses autres sens au bout d’une longue période sombre où l’avait conduit une interminable maladie à soigner, maladie qui avait eu raison de sa douce. Elle avait toujours administré le ménage, lui était nul à chier avec les chiffres, une dépression sévère qui avait suivi, les mauvaises surprises d’une succession acceptée à la hâte sans vraiment connaître l’état des lieux, les dettes et toute cette sorte de travers épineux et de sagas familiales. La ville réclamait maintenant ses clés de maison pour quelques dollars de taxes impayées. L’autre saurait encore l’accommoder, s’était-il dit, une fois de plus, bien que l’argent n’est-il pas aux vieilles amitiés ce que la cigüe est aux amours trahis?
Il traversa le long tunnel désert, repéra la bonne adresse civique et regarda par deux fois son papier, les propriétaires n’habitent-ils pas le rez-de-chaussée habituellement? Il entreprit l’escalade des marches grises du long escalier, une à une comme un chemin de croix, se demandant à chacune d’elles s’il ne tournerait pas les talons. Mais il se rendit à la porte, il tourna la bobinette d’un autre âge et l’autre l’attendait déjà au bout du son de la cloche mécanique. Accolades précipitées, quelques banalités et déjà ils étaient installés à la table. Leur apparurent chacun une bonne bière froide dans un long verre suintant comme dans les publicités. L’un et l’autre ne s’étaient pas vus depuis les funérailles.
L’un veuf, l’autre était redevenu le vieux garçon que tous voyaient depuis toujours en lui et il vivait maintenant seul à nouveau.Sa douce des dernières années envolée avec un artiste miséreux mais soi-disant génial. À le regarder, il devinait bien que l’autre devait encore à l’occasion retourner de l’autre côté des délires voir s’il s’y trouvait encore quelqu’espoir.
Encore une fois, ils semblaient coller ensemble dans le fond du poêlon merdeux du destin. De bière en bière, ils en ont sifflé quelques-unes à la vie dont celle de trop comme toujours. L’alcool transformait l’autre à la vitesse grand V, le crâne rose et nu et le front lui perlaient à grosses gouttes, il ramenait aux dix secondes ses lunettes qui glissaient le long de son appendice nasal impressionnant et luisant de sébum. La bouche s’était empâtée, le discours avait repris cette bonne vieille incohérence à la limite violente qu’il lui connaissait depuis toujours.
Affrontant ses démons, à genoux sur sa gêne et tout nu dans sa honte, il déballa son pénible imbroglio et en appela à leur vieille amitié encore une fois. Il savait d’instinct que la situation embarrassait l’autre autant que lui. Au bout d’un moment, l’autre sortit sa ridicule sacoche de gars, en sortit en marmonnant un chéquier et se mit à griffonner, les yeux exorbités, excédé. En lui lançant presque au visage le bout de papier qui pour lui pesait le poids d’une maison, il lui beugla: “Tiens, je t’en donne rien que la moitié, prends ça puis va-t-en. Je suis certain que je ne te reverrai plus jamais la face de toutes façons, tu ne me rembourseras jamais.”
Et il est reparti sans un mot, assommé. L’autre l’avait comme achevé. Tué.
…
Il avait longuement déambulé dans la chaleur torride de ce maudit après-midi d’été cherchant à se recomposer, à examiner ses options. Comme si la traître blessure d’amitié ne l’avait pas frappé assez raide, une autre saynète humiliante l’attendait quelque part sur terre, une autre moitié de somme à trouver et cela pesait huit tonnes sur ses épaules. Ça ou le poids d’une maison. En retrouvant sa Chevrolet au bout de sa triste course, son visage était encore décomposé, les yeux rougis. Une contravention battait au vent sur le pare-brise. Évidemment.
Il n’avait pas remarqué la vieille dame au dos arqué qui s’avançait vers lui poussant devant elle un paquet de sacs dans un pousse-pousse de toute évidence ramassé aux vidanges. Tout près de lui maintenant, elle l’observait avec une douce compassion au fond des yeux. “Voyons donc pauvre monsieur, mettez-vous pas dans un état pareil pour un hostie de ticket!”, lui dit-elle.
“Ciboire, Olivette, tu comprends rien ni du cul ni de la tête, qu’est-ce que tu fais encore dans l’histoire?” Olivette était frustrée, elle voulait savoir le fin mot, qui était qui?, qu’est-ce qui est arrivé au gars dans le vestibule la face dans le cash?, la dette avait-elle été remboursée?, les amis s’étaient-ils retrouvés?
“Je te l’avais dit Olivette, de ne jamais rouvrir ce sac-là. L’argent et l’amitié, ça ne se mélange pas, ensemble ça surit, ça caille, ça finit par sentir la mort. Le début de l’histoire n’a pas de fin parce que ce n’est pas la fin de l’histoire, ce n’est peut-être même pas une histoire, pas encore du moins, ou ça ne l’a jamais été. Il faut savoir lire entre les lignes, démêler le vrai du fantasme. Remets tout ça dans le sac et on en parle plus, s’il vous plaît, s’il vous plaît.”
Mais elle rongeait son frein solide. “Non, tabarnak, je ne vais pas laisser ça de même. Je retourne dans le parc, donne-moi l’adresse de l’autre, je vais aller le voir, j’vas y parler moé christ, ça ne se fait pas des affaires de même.” Elle était déchaînée.
Vues les circonstances particulières j’ai quelque peu renié mes propres règles. “OK, d’abord, tu veux une fin? Tu veux un beau petit rôle dans la fin? Si tu me promets de remettre la boîte dans son sac, de rattacher le sac et de le remettre dans le fond du tas pour toujours, assis-toi je vais conclure, juste pour toi.”
Un gros YES, répondit-elle le sourire large comme un gros truck. “Promis juré !” Et elle faillit me cracher sur le pied.
…
Avant qu’il n’ait eu le temps de déplier ses vieux genoux et de se remettre debout en appuyant ses mains sur la porte, la lumière jaillit de partout en même temps que la porte s’ouvrait d’une claque devant lui. Il perdit appui et s’écrasa lamentablement, le visage dans la petite montagne de billets, aux pieds de l’autre bien debout les orteils dans le fric éparpillé.
Un long et malaisant silence a immobilisé la scène un temps, le temps que tout un chacun réalise ce qui se passait là. En ouvrant précipitamment la porte, un vacuum vers l’extérieur avait emporté avec lui quelques billets. L’autre criait: “Fuck, tasse-toé, le cash s’en va!”. En le contournant, il s’était mis à chasser désespérément le dollar comme autant de papillons fous d’un bout à l’autre du balcon dans une chorégraphie déjantée digne de Béjart. Lui s’enfuit dans la confusion en descendant les marches deux par deux, au diable les locataires qui dormaient. L’autre ne l’avait pas reconnu de toute évidence. Vingt ans pas de son, pas d’image, c’est pas rien. Lorsqu’il atteignit le trottoir, l’autre s’était avancé sur la balustrade et criait à celui d’en bas: “T’es qui toé, c’est quoi cet argent-là, d’où ça sort? Qu’est-ce qui se passe icitte à soir, ciboire?”
Lui s’est immobilisé sur le trottoir, il savait que la pénombre protégeait son visage. C’était écrit dans le ciel qu’il ne lui reverrait jamais plus la face. Il regarda l’autre en haut sur le balcon du deuxième et lui dit simplement: “Fais ce que tu veux avec, c’est toute à toé ce beau fric-là! Sais-tu quoi? Marche jusqu’au parc, il y a une vieille folle qui est assise à côté de la vespasienne. Ça fait longtemps qu’elle ne s’est pas lavée, elle sent pas bon. Amène-là chez vous, prête-lui ta douche. Avec le fric, va lui acheter une belle robe chez Ogilvy, des beaux souliers à talons hauts qu’on rigole un peu. Rapporte-lui une belle boîte de chocolats en chemin, elle capote sur le chocolat. Ensuite, amène-là dans un des petits restaurants à la mode sur Villeray, laisse-la se bourrer dans les tapas. Ça fait longtemps qu’elle se nourrit dans les conteneurs de restaurant. Offre-lui une bonne bouteille de rouge à cent piastres, le dessert le plus cher, un grand Cognac pour finir.
Et quand le garçon apportera l’addition, payes-en juste la moitié puis sauve-toé.”
…
“Ah ça c’est chien Luc St-Pierre, t’es rien qu’un si pis un ça!”, bougonnait Olivette en remettant la boîte de Black Magic dans le sac, en faisant trois-quatre noeuds d’dans et en l’enfouissant en-dessous de la pile comme promis.
Ben bon pour toé, Olivette.
Flying Bum