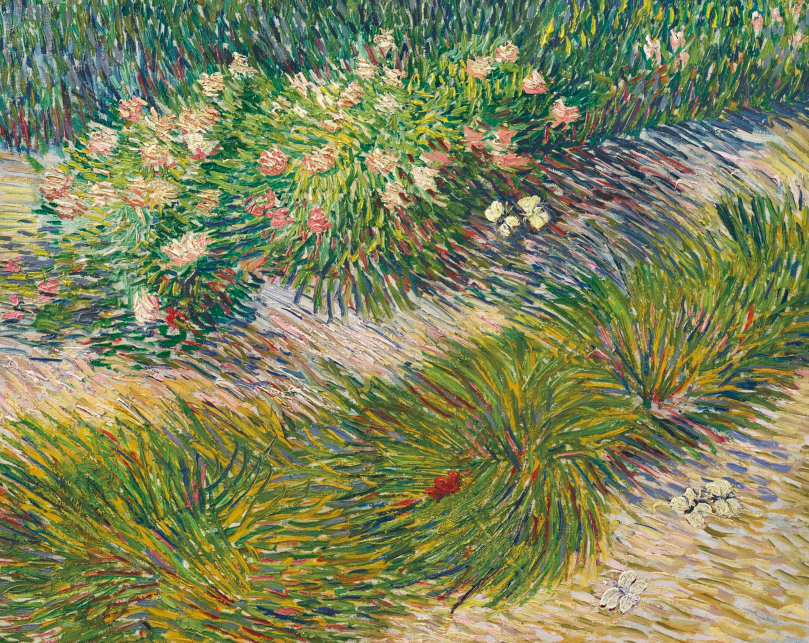Le 1er mars à Brighton au Royaume-Uni, Céline est décédée. Je ravale ma salive. J’essaie de comprendre ce qui me trouble autant. La choquante proximité d’un nom que je connais si bien avec les mots “est décédée” tout juste à côté. Tomber face à face avec la mort sur un ridicule écran de téléphone me désoriente totalement, même si je sais que personne n’est éternel. Personne. Et ces amis surgis du passé qui se rappellent soudain à moi dans la même tristesse paralysante.
Cela ressemble en tous points à une violente réaction viscérale à la fin d’un film lorsque tout se dévoile ou bien meurt. Céline adorait les films. Et les violentes réactions viscérales.
***
C’est en lisant un poème d’Anna de Noailles, J’écris pour que le jour, il y a moins d’un an, que j’ai repensé à elle, allez savoir pourquoi, et je l’ai contactée. Et j’ai appris ébaubi sa fin imminente.
J’ai marqué chaque jour la forme des saisons,
Parce que l’eau, la terre et la montante flamme
En nul endroit ne sont si belles qu’en mon âme !
J’ai dit ce que j’ai vu et ce que j’ai senti,
D’un cœur pour qui le vrai ne fût point trop hardi,
Et j’ai eu cette ardeur, par l’amour intimée,
Pour être, après la mort, parfois encore aimée,
Et qu’un jeune homme, alors, lisant ce que j’écris,
Sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris,
Ayant tout oublié des épouses réelles,
M’accueille dans son âme et me préfère à elles…
***
Je ressens une bonne part de culpabilité quand je réalise que je ne savais même pas si elle était toujours vivante tout ce temps-là. Que cette éternelle amitié promise, comme tous les serments des anciens amants, s’égrenait lentement dans l’air du temps. Après quarante ans et le plus grand des océans, pourquoi, comme une éternelle muse, se rappelait-elle toujours à mes pensées.
And you call me up again just to break me like a promise
So casually cruel in the name of being honest
I’m a crumpled up piece of paper lying here
’Cause I remember it all, all, all too well.
Taylor Swift, Red.
***
Il existe une multitude de raisons pour lesquelles tout peut aller de travers. Tourner à la catastrophe, au drame, ou pire dans l’oubli, que la fin se fait un devoir de devenir inévitable. Il y avait un grand vide. Cela l’effrayait; elle tentait de le remplir. Elle semble avoir réussi au-delà de ses propres espérances, comme elle me le racontait récemment. Mais pour moi c’est comme si le temps révolu n’était que la réaction de toute cette sorte de choses qu’on peut lancer dans ce vide pour le remplir et qu’on devient les victimes collatérales de cette injuste fausseté. Mais encore, il existe une mince chance que c’était la bonne chose à faire, la parfaite solution, l’œuvre impeccable, et si, oui mais si, mais encore . . . on se perd.
Espérer se retrouver dans celui qu’on était avant de rencontrer celle qui nous a jadis élevé le coeur et l’a tenu au bout de ses bras pour un moment c’est comme espérer comme un vrai fou la machine à voyager dans le temps. Le passage du temps réécrit le passé et nous tentons désespérément de blanchir nos âmes au passage, mais le mieux que l’on puisse faire c’est de les effacer encore un peu plus.
Céline est décédée et déjà son silence transforme les mots qu’elle m’a inspirés. Leur donne une force nouvelle et une parcelle d’éternité inespérée.
Elle a été une Isabelle, quelques Adéline, une rare Marie-Luce et des fragments d’elle colorent bien des personnages, dans d’autres de mes récits, comme toute bonne muse s’amuse à se cacher partout.
***
De la façon dont elle aspirait la fumée de ses clopes en creusant ses joues par en-dedans, la façon dont elle tordait jadis une poche de thé, à la façon dont elle peignait ses ongles, montait ses toques, rien ne lui échappait; lui, tout le charmait, tout lui semblait drôle. Une tomate, trois concombres sur le dessus du frigo, rien ou presque en-dedans sauf à boire, comment par crainte des voisins elle étouffait ses propres cris, ses dents dans le creux d’un cou, en enfonçant ses ongles dans la chair d’un dos, rien, rien ne lui échappait. Elle savait aimer, elle ne savait juste pas comment aimer du début jusqu’à la fin. Les fins étaient toujours abruptes. Douloureuses. Comme ses brûlantes étreintes.
Extrait de : La comète aussi mourra, qu’on peut lire ici :
***
C’est comme ça que ça m’apaise de me rappeler de nous. . . le soleil de plomb qui nous draine jusqu’à la dernière goutte de sueur et qui nous fait dire, “T’en voulais du soleil, t’en as-tu assez pour ton argent?” Quand nous nous aspergions le corps avec des bouteilles de push-push mal rincées qui donnaient à nos sueurs une fraîche odeur de lave-vitres. Et que nous étions cassés comme des clous, moi qui lettrais à la main au pinceau des affiches d’épicerie de coins de rue, elle qui vendait du chocolat chez Laura, des millionnaires l’un pour l’autre. Nous les freaks intellos qui se moquions de tous ces gogos qui préféraient les émotions de La Ronde à celles de la mescaline ou du LSD tout en râpant de nos dents la dernière chair tendre collée à la peau raide d’un morceau d’Oka.
Extrait de : La théorie des olives, qu’on peut lire ici :
***
Isabelle était belle comme ses quatorze ans et elle savait se faire plus belle que les plus belles actrices françaises avec des fringues payées à la livre dans les sous-sols d’église. Il m’arrivait de squatter son petit logis lorsqu’englouti dans l’instant présent je manquais le dernier autobus du soir. Isabelle et moi dormions alors serrés l’un contre l’autre entraînés dans les angles inconfortables d’un divan-lit bancal, elle en vêtements de nuit, moi dans mes bobettes de coton blanc. Je ne savais jamais si elle fréquentait sérieusement quelqu’un ou non et cela n’avait alors aucune espèce d’importance pour moi. Nos corps se laissaient volontairement s’emboîter immobiles dans la même chaleur réconfortante sans s’inventer d’autres histoires et nous trouvions le sommeil ainsi. Nous pouvions alors devenir à nouveau ces enfants qui se cachaient toujours quelque part dans un recoin de nous.
Extrait de : Les mal partis, qu’on peut lire ici :
***
Le long de la 117 dans le parc de La Vérendrye, sur les parois rocheuses, des initiales souventes fois gravées ou peintes deux par deux, des prénoms, des coeurs et des flèches, des chiffres pour des années, le temps qui est, le temps qui passe, le temps qui fût. Sur les arbres, les bancs, la pierre, de tout temps les amoureux ont laissé des traces de leur histoire. Cela donne à l’imagination du passant le plaisir de deviner bien des histoires qui sont mortes et enterrées depuis belle lurette. Les âmes immortelles des amoureux rôdent toujours pas tellement loin de ces marques, on peut parfois les sentir. Mais bien d’autres ont pris des chemins différents et trouvé d’autres compagnons de route ailleurs et parcouru leur propre destin sous d’autres cieux. Des décennies peuvent s’écouler, mais des siècles ne sauraient effacer les puissants instants et les sentiments profonds qui furent jadis et qui unirent les êtres pour un moment et rien ne devrait nous soustraire à la joie de leur offrir de temps à autres une forme ou une autre de souvenir, de célébration.
Extrait de : Le grand remous, qu’on peut lire ici :
***
Elle rejoint aujourd’hui l’imaginaire où elle a toujours été chez elle, comme dans la noirceur d’une salle de cinéma, fillette sur un quai de la Châteauguay, sous la triste pluie de Brighton ou sur la grève du Grand-Remous, dans un chiche studio de Rosemont ou ailleurs. C’est là qu’elle demeure désormais. Elle demeure ailleurs et un peu à tous ces endroits à la fois.
Et si elle revenait, comme pour tous mes vieux amis, la conversation reprendrait exactement où elle avait été laissée. Les mots se rabouteraient nonobstant le temps qui coupe les phrases en deux. Ces conversations magiquement ressuscitées sont autant de grimaces de singe lancées à la face même du temps. Peu de gens peuvent vraiment comprendre ce mystère. Un moment indéfini d’absence devient comme un signet, planté dans un livre, l’histoire de deux vies qui revit dès qu’on tire le signet et qu’on retrouve la trame, les personnages, le plaisir, aussi fort, puissant. C’est le langage des vrais amitiés.
Et lorsque survient la mort qui vient nous prendre par surprise, crétins que nous sommes, la ligne est coupée sec et nous restons coincés dans le sombre silence de nos seuls mots. L’amitié devient alors une histoire que l’on se raconte maintenant tout seul avec soi-même la plupart du temps.
Et nous regrettons.
Flying Bum

À Céline, avec mes plus vives sympathies à sa fratrie, Bernard que j’ai un peu connu, Ronald, Sylvie et tous ceux qui devront se parler d’elle tout seuls maintenant.